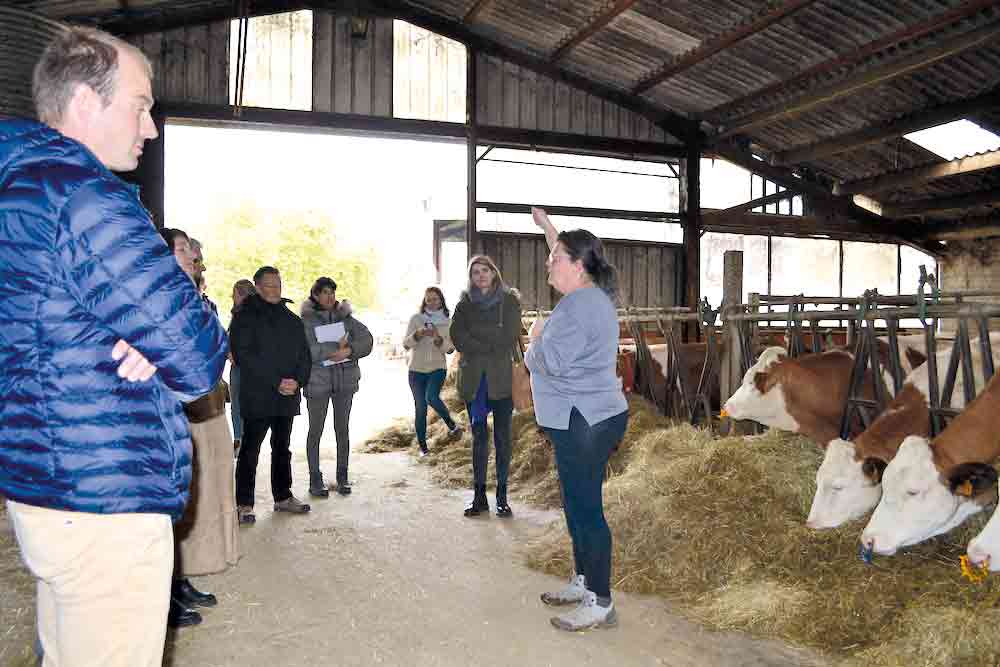Agra
Fil info
Alors que les ambassadeurs de l’UE doivent se prononcer le 9 janvier à l’occasion d’une réunion du Coreper II sur l’accord commercial UE-Mercosur, la question de l’application provisoire de l’accord intérimaire suscite la controverse. En cause : le retrait à la dernière minute d’une déclaration annexe qui précisait que cette application provisoire serait bien soumise au consentement formel du Parlement européen. « Un déni de démocratie pur et simple après plusieurs passages en force », dénonce avec vigueur le 8 janvier l’eurodéputée Française Céline Imart (droite) dans un message posté sur le réseau social X, qualifiant la décision de Nicosie de « faute lourde ». Un sentiment partagé par son collègue centriste Pascal Canfin qui avance que « le Parlement européen ne peut pas l’accepter ! ». Cette possibilité d’application provisoire sans avis du Parlement européen ne serait cependant pas contraire à ce que prévoient les traités européens en la matière. Toutefois, pour qu’elle puisse se matérialiser, la ratification par au moins un des pays du bloc sudaméricain reste nécessaire. Elle commencerait alors le premier jour du deuxième mois suivant la notification de l’accomplissement des procédures internes des deux côtés. De son côté, la présidence chypriote du Conseil de l’UE assure vouloir suivre la procédure standard en lien avec les traités sans mettre de côté le Parlement européen.
«La France a décidé de voter contre la signature de l’accord entre l’Union européenne et les pays du Mercosur», a déclaré le président Emmanuel Macron, dans un communiqué publié le 8 janvier. Cette intervention confirme la position de la France à la veille d’une réunion décisive des ambassadeurs de l’UE qui devraient entériner l’autorisation de signature de l’accord commercial par la Commission européenne. Si le chef de l’Etat reconnaît «des avancées concrètes» sur les demandes françaises (clause de sauvegarde spécifique, réciprocité des normes, renforcement des contrôles), «le constat doit être dressé d’un rejet politique unanime de l’accord». Mais, comme la ministre de l’agriculture Annie Genevard, il veut croire que «l’étape de la signature de l’accord ne constitue pas la fin de l’histoire» alors que le texte devra obtenir le consentement du Parlement européen.
Source Agra
Agra
Comme annoncé par le Premier ministre Sébastien Lecornu, le 4 janvier, la France suspend, par un arrêté paru au Journal officiel le 7 janvier, l’importation, l’introduction et la mise sur le marché de denrées alimentaires provenant de pays tiers à l’Union européenne (UE) contenant des résidu de cinq substances actives phytopharmaceutiques interdites d’utilisation dans l’UE : bénomyl, carbendazime, glufosinate, mancozèbe, thiophanate-méthyl. La mesure, qui concerne principalement des fruits et légumes (avocats, mangues, agrumes, pommes, poires, tomates…), suscite toutefois des critiques au sein de la filière des fruits et légumes. Pour Daniel Sauvaitre, président d’Interfel, la réponse apportée « manque sa cible, la principale concurrence étant intra-européenne ». Selon lui, « si le message envoyé au consommateur est de vouloir le protéger, il aurait été possible d’ajouter l’acétamipride à la liste des substances interdites, ce qui aurait eu un effet direct sur la concurrence au sein même de l’UE ». En outre, M. Sauvaitre s’inquiète que cette mesure « jette le trouble sur la qualité sanitaire de ce que les consommateurs ont sur les étals, pourtant garantis par l’Anses et l’Efsa ». Prise à titre conservatoire, l’interdiction prendra fin dès l’entrée en application de mesures appropriées par la Commission européenne ou à défaut un an après son entrée en vigueur
Agra
A l’occasion d’une réunion, le 7 janvier en format Triangle de Weimar plus avec leur homologue indien, Subrahmanyam Jaishankar, les ministres des Affaires étrangères français, allemand et polonais ont appelé à la conclusion rapide d’un accord commercial et sécuritaire entre l’UE et l’Inde. « L’accord de libre-échange est une étape importante vers davantage de diversification », a affirmé l’Allemand Johann Wadephul, alors que le contexte commercial international reste incertain. Et d’ajouter: « C’est pourquoi nous travaillons intensément à Bruxelles pour conclure bientôt cet accord ». Un sommet entre l’UE et l’Inde est d’ailleurs prévu le 27 janvier. Serpent de mer des négociations commerciales depuis plusieurs années en raison notamment de divergences sur l’agriculture, les pourparlers entre les parties se sont, semble-t-il, intensifiés à la fin de l’année 2025. Pour faciliter la négociation, le sucre et les produits laitiers ont d’ailleurs été exclus des discussions. Bruxelles plaide notamment pour l’ouverture du marché indien à ses voitures et ses boissons alcoolisées (les vins et spiritueux sont fortement taxés) alors que, de son côté, l’Inde souhaite vendre plus facilement ses produits textiles ou ses médicaments.
Agra
Les Etats membres devraient bel et bien valider, le 9 janvier à l’occasion de la réunion des ambassadeurs de l’UE (Coreper II), la décision autorisant la Commission européenne à signer l’accord commercial UE-Mercosur. L’Italie, qui avait temporairement fait basculer le destin de l’accord en décembre, a obtenu les garanties agricoles qu’elle demandait, ouvrant ainsi la voie à une signature du traité le 12 janvier au Paraguay. Au niveau procédural, la nouvelle présidence chypriote du Conseil de l’UE devrait constater, lors de la réunion du Coreper II, l’absence de minorité de blocage avant d’avancer par procédure écrite, compte tenu de l’absence de réunion officielle des ministres. L’issue est espérée dès le 9 janvier. S’exprimant le 7 janvier à la sortie de la réunion extraordinaire des ministres de l’Agriculture à Bruxelles, Annie Genevard a, elle, semblé résignée sur le destin de l’accord au Conseil de l’UE. Malgré son opposition au traité, elle renvoie à présent vers le Parlement européen. « Ce n’est pas la fin de l’histoire », veut-elle croire alors que Strasbourg sera amené à se prononcer sur l’accord prochainement. Concernant la clause de sauvegarde agricole, dont le compromis sera aussi soumis aux ambassadeurs de l’UE le 9 janvier, les modifications devraient finalement concerner uniquement les seuils de déclenchement des enquêtes. Ceux-ci devraient être abaissés à 5% sur une moyenne triennale conformément à la position du Parlement européen (contre 8 % dans le compromis de décembre) afin de faciliter l’adoption du texte par les colégislateurs.
Agra
«La taxe carbone sur les engrais pourra être suspendue avec effet rétroactif au 1er janvier 2026. C’est une excellente nouvelle et un soulagement pour nos agriculteurs!», s’est félicité la ministre de l’Agriculture Annie Genevard à l’issue d’une réunion d’urgence des ministres de l’Agriculture de l’UE à Bruxelles le 7 janvier. En effet le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic a confirmé que le règlement amendant ce mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, proposé mi-décembre, permettrait de suspendre temporairement son application pour les engrais. Il s’est engagé à ce qu’une fois adopté par les colégislateurs – d’ici le mois de février – cette disposition puisse entrer en vigueur de manière rétroactive au 1er janvier 2026. «Il n’y a donc aucune justification que les importateurs d’engrais augmentent leurs prix», a prévenu Annie Genevard. Par ailleurs, la Commission européenne a aussi proposé, le même jour, de suspendre temporairement les droits de la nation la plus favorisée (NPF) restants «sur l’ammoniac, l’urée et, le cas échéant, certains autres engrais». «Cette mesure pourrait entrer en vigueur rapidement en 2026 et serait globalement du même ordre de grandeur que les coûts découlant du MACF», souligne-t-elle. Cette annonce est une «bouffée d’oxygène», a réagi Antoine Hacard, président de Métiers du Grain à La Coopération Agricole, dans un communiqué. Il attend toutefois des précisions sur leur mise en place, et à l’avenir, des mesures plus structurelles «pour sécuriser l’approvisionnement en engrais».
Agra
En raison du risque sanitaire lié à la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), les organismes de sélection (OS) des races bovines ont décidé de ne pas participer au Concours général agricole, qui se déroule en même temps que le Salon de l’agriculture. Dans un communiqué du 7 janvier, les organisateurs du Sia ont indiqué prendre acte de cette décision, qui « relève exclusivement de [la] responsabilité » des OS. Et de préciser que le Salon a « pour sa part, toujours souhaité la présence de bovins et a tout mis en œuvre pour la rendre possible, dans le strict respect des conditions sanitaires en vigueur ». Des discussions se poursuivent sur l’éventualité d’une « présence de bovins, même limitée et symbolique », via « un nombre restreint d’animaux, dans une logique de souplesse adaptée » ; le Sia prévoit de communiquer « mi-janvier » sur ce sujet.
Agra
A la veille d’une réunion exceptionnelle à Bruxelles entre les ministres de l’agriculture et la Commission européenne, sa présidente Ursula von der Leyen propose dans une lettre du 6 janvier une rallonge de 45 milliards d’euros pour la future Pac. Elle suggère un amendement à sa proposition de cadre financier pluriannuel 2028-2034 pour que les États membres «aient accès, lors de la soumission de leur plan initial, à deux tiers maximum du montant normalement disponible pour l’examen à mi-parcours (en 2030). Cela représente environ 45 milliards d’euros mobilisables immédiatement pour soutenir les agriculteurs». Ces fonds ne seront pas soumis à l’inflation. Dans sa proposition actuelle, pour la prochaine Pac Bruxelles prévoit une enveloppe minimale de 300 Mrds€ soit une baisse d’environ 20% par rapport au budget actuel. De plus la présidente de la Commission ouvre la porte à une utilisation des fonds prévus pour l’«objectif rural» (10% du budget communautaire) pour des mesures agricoles, ce qui n’était pas le cas pour l’instant. Le développement rural pourrait donc bénéficier de 48,7 Mrds€ dans ce cadre. Ursula von der Leyen affirme que ces instruments apporteront «un soutien sans précédent, parfois même supérieur à celui du cycle budgétaire». Le think tank agricole Farm Europe prévient que cette proposition reste une simple «possibilité, pas une garantie pour les agriculteurs qui devront la sécuriser dans les décisions de chaque Etat membre de l’UE». Pour la France, « pas un seul centime ne doit manquer » par rapport au budget actuel. Elle pousse en ce sens, avec l’Italie notamment. Et le ministère de l’Agriculture «nourrit de bons espoirs» d’y parvenir. Paris espère aussi obtenir des garanties pour empêcher une renationalisation de la future Pac.
Agra
À l’occasion d’un point avec la presse le 6 janvier, avant son entrevue avec le Premier ministre, le président de la FNSEA Arnaud Rousseau a précisé le contenu de sa « loi d’exception agricole », qu’il a appelé le gouvernement à porter le 4 janvier. Tout en précisant que le contenu du texte restait « à rédiger », il propose trois thèmes : l’eau, la prédation et les installations classées pour l’environnement (ICPE). L’agriculteur n’a pas détaillé le contenu précis des mesures, souhaitant simplement qu’elles puissent faire avancer ces dossiers avant la présidentielle, « sans sortir du cadre légal ». Dans son courrier aux agriculteurs, publié le 4 janvier, Sébastien Lecornu a indiqué « ne pas être opposé à une loi exceptionnelle », à condition qu’elle soit construite « avec toutes les forces présentes au Parlement pour qu’elle puisse réellement vite aboutir ». Concernant le calendrier, « le plus tôt sera le mieux », estime Arnaud Rousseau, car « après l’été, nous serons déjà dans la présidentielle ». La loi votée pour la reconstruction de Notre-Dame, dont s’inspire la FNSEA, contenait plusieurs habilitations à agir par ordonnances, qui permettraient dans ce cas au gouvernement de travailler malgré le début de la campagne présidentielle. Interrogé sur l’opportunité d’y insérer la question de l’acétamipride, le président de la FNSEA a simplement indiqué qu’un débat doit avoir lieu prochainement sur la loi Entraves, qui sera certainement l’occasion d’en discuter pour les parlementaires.
Agra
La France espère bien être encore en mesure d’obtenir la suspension du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) et le renforcement de la mesure de sauvegarde dans le cadre de l’accord UE-Mercosur. Le MACF sera l’une des demandes principales que poussera la ministre de l’Agriculture Annie Genevard, le 7 janvier à l’occasion de la réunion politique extraordinaire avec ses homologues européens. Selon le ministère, la France est à la manœuvre pour obtenir le ralliement d’autres Etats membres à sa coalition et ainsi forcer la décision de Bruxelles. Actuellement, la position française est soutenue par la Pologne, l’Italie, l’Autriche, le Portugal, la Hongrie, la Roumanie et l’Irlande. Parallèlement, bien que n’étant pas officiellement à l’ordre du jour, la question de l’accord commercial UE-Mercosur devrait sans doute être soulevée. Interrogé sur la question, le ministère de l’Agriculture estime qu’il n’est pas exclu que pour faciliter son adoption, l’accord sur la sauvegarde agricole puisse encore évoluer dans le sens demandé initialement par le Parlement européen. Mais Paris demande aussi la prise de mesures miroirs pour les denrées animales et végétales exportées vers l’UE ainsi qu’un renforcement et un accroissement des contrôles aux frontières.
Agra
À la une

Aveyron | Par La rédaction
CUMA de Laguiole : 4ème service de piégeage de campagnols



National | Par Actuagri
La FNB veut enrayer la décapitalisation