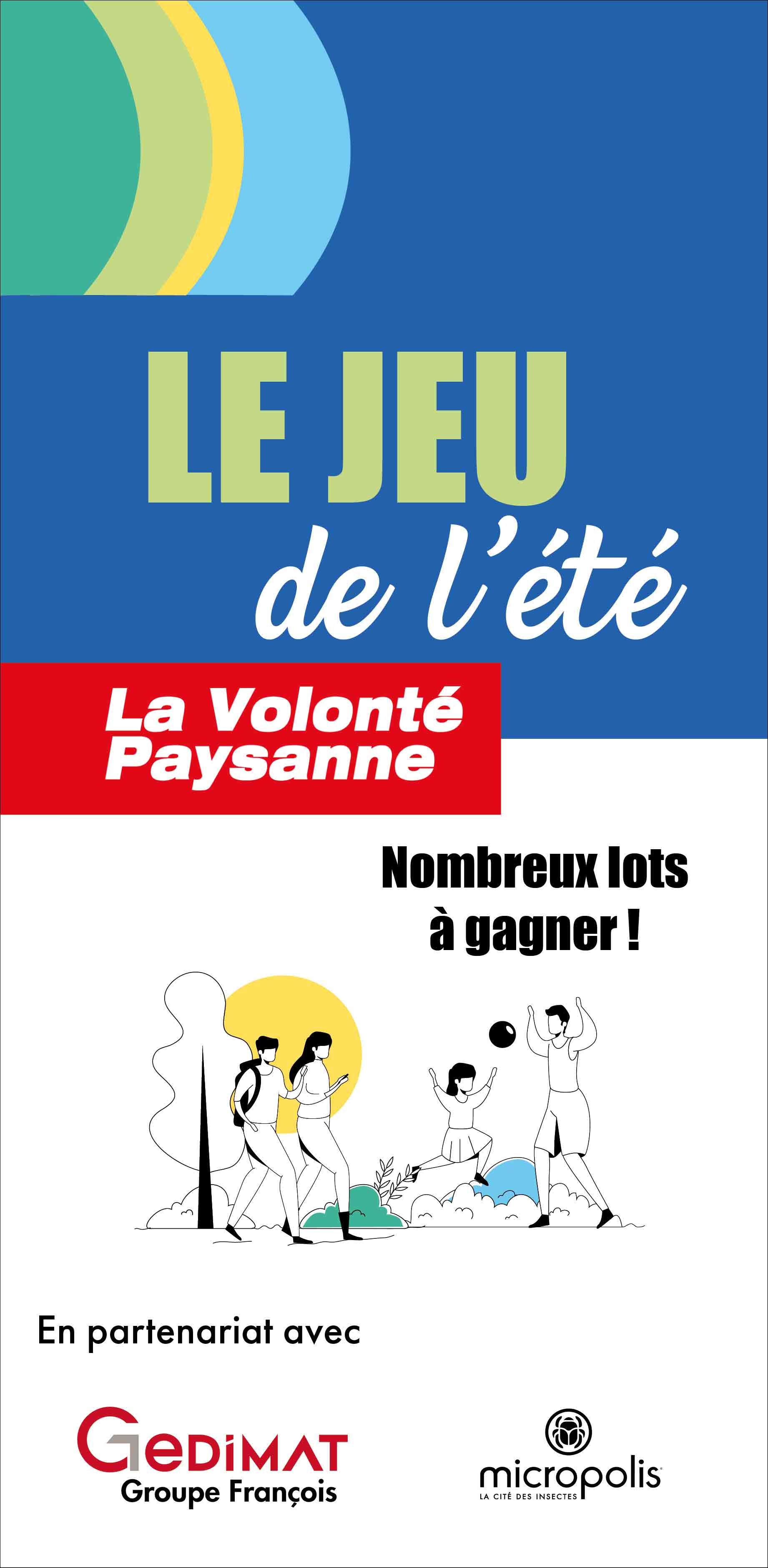Par La rédaction
Bovins/DNC: stratégie vaccinale non achevée, fermetures de marchés à l’export
A l’occasion d’une réunion avec les professionnels le 7 juillet, la DGAL (ministère de l’Agriculture) a indiqué que la stratégie vaccinale contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) était toujours en cours d’élaboration. La DGAL a confirmé que le mode de dispersion de la maladie était principalement les stomoxes et les taons (insectes), ce qui est rassurant car ils ne multiplient pas le virus et leur comportement est relativement sédentaire. «Une course contre la montre» commence toutefois, explique-t-on chez GDS France. Compte tenu de son statut en Europe (maladie à éradication immédiate), les professionnels s’attendent à la poursuite des dépeuplements, et à une vaccination obligatoire sur une zone qui reste à déterminer . Le traitement des chevaux dans les zones réglementées a été soulevé par les professionnels, qui demandent leur inclusion dans les dispositifs. D’après deux professionnels interrogés, le laboratoire fabricant de ces doses serait situé en Afrique du Sud. En attendant, des marchés se ferment, notamment la Chine et la Corée du Sud pour la viande, le Japon pour les abats, le Canada et le Royaume-Uni pour les produits laitiers non pasteurisés, rapporte la DGAL.