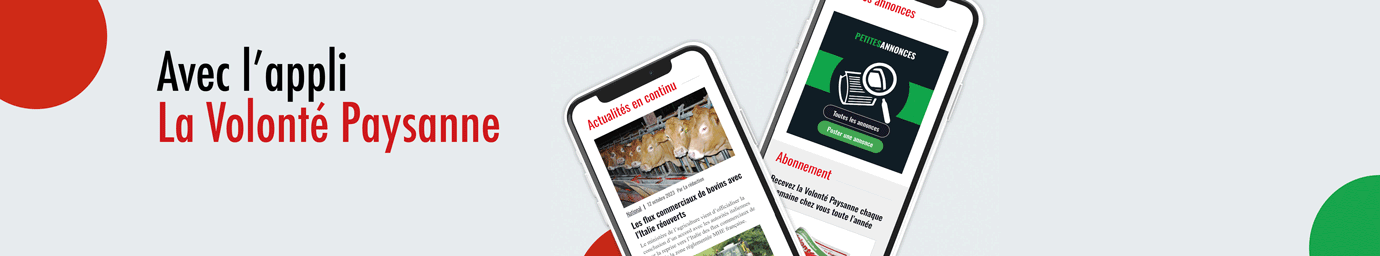Fil info
À la une

National | Par eva dz
L’herbe, une production paysanne à part entière
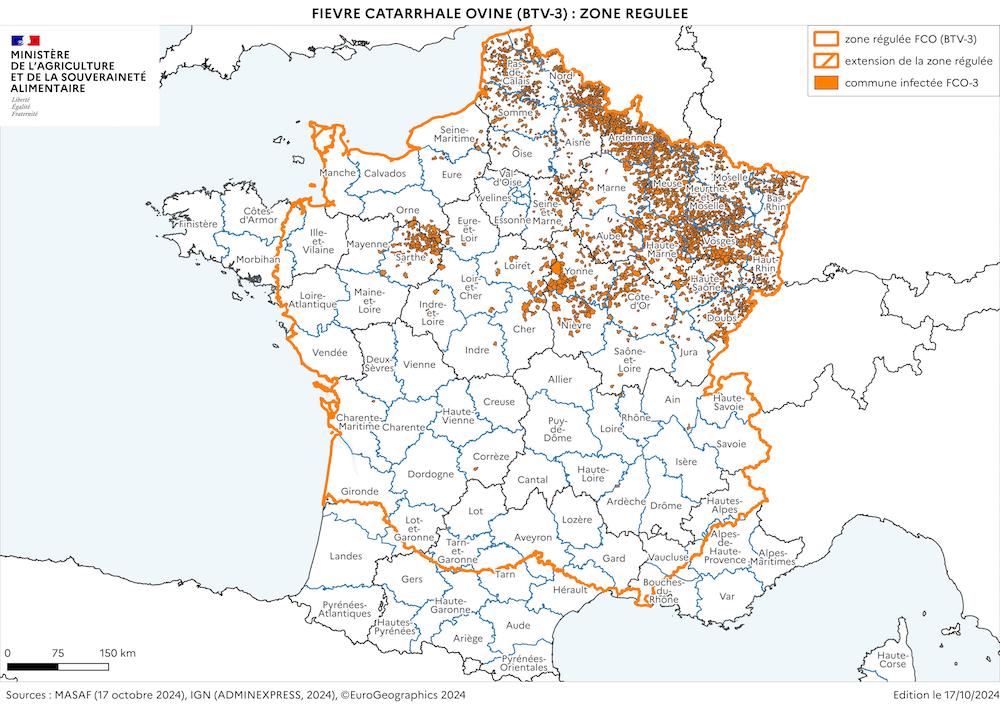
Aveyron | Par La rédaction
FCO 3 : l’Aveyron en zone régulée

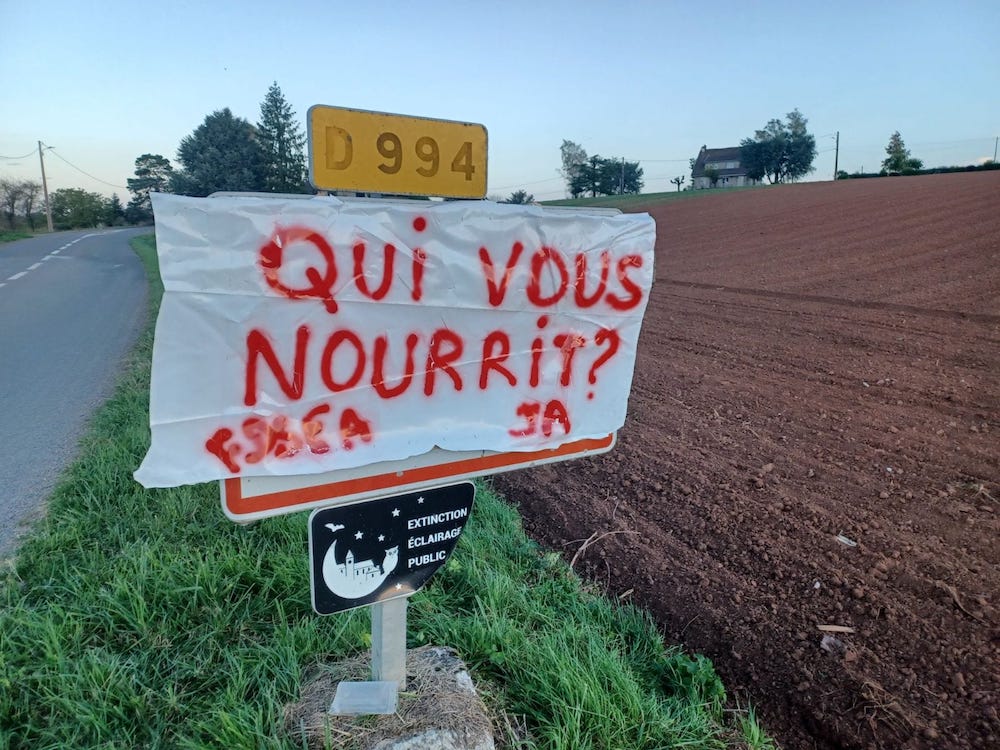
Aveyron | Par La rédaction
FDSEA et JA repartent à l’action