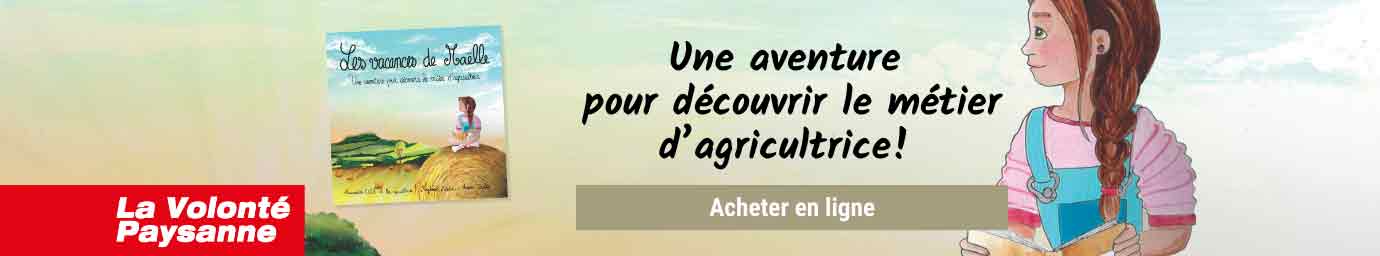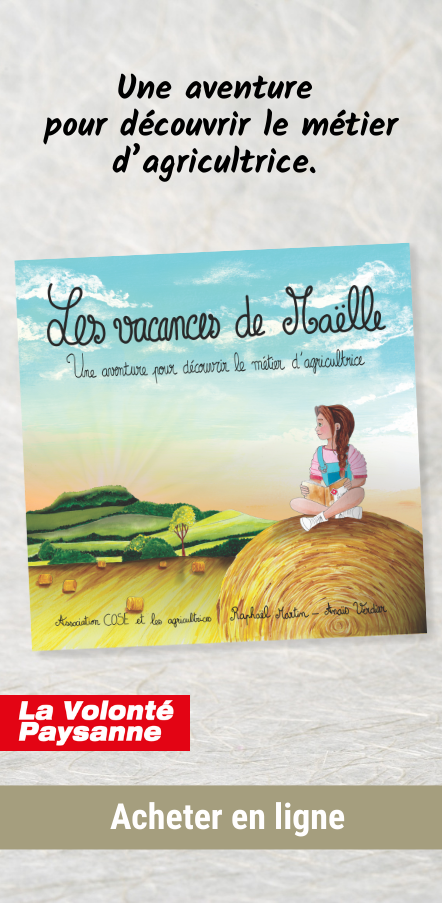Après deux années de hausse grâce au rebond économique post-Covid, la consommation totale de viande est repartie à la baisse en France en 2023, selon une note de synthèse FranceAgriMer/SSP (ministère de l’Agriculture) publiée le 27 juin. Calculés par bilan*, les volumes consommés dans l’ensemble des circuits de distribution ont reculé de 1,4% l’année dernière (-1,7% par habitant). Seules les volailles sont en croissance (+3,5%, à 2 Mtéc), grâce à la reprise de la production après l’influenza aviaire et à la détente des prix de l’alimentation animale, qui a permis de mieux maîtriser l’inflation. Ce rebond concerne en particulier le poulet (+3,7%) et le canard (+13%), visé par la campagne de vaccination. «La consommation de volailles de chair retrouve sa trajectoire de hausse observée depuis vingt ans» (+3,9% par an). Au contraire, les viandes bovine et porcine, pénalisées par l’inflation, atteignent leur plus bas niveau depuis vingt ans: 1,45 Mtéc pour le bœuf (-3,7%/2022) et 2,09 Mtéc pour le porc (-3,7%) – qui reste la viande la plus consommée. Les importations, quant à elles, suivent les tendances de consommation (-6% en bœuf, -5,9% en porc, +4,4% en poulet). À l’exception notable de la viande ovine, pour qui la part des importations s’accroît (+2 points) malgré une production et consommation en baisse (-4,2%, à 149 Mtéc). * Production – exportations + importations
La rédaction