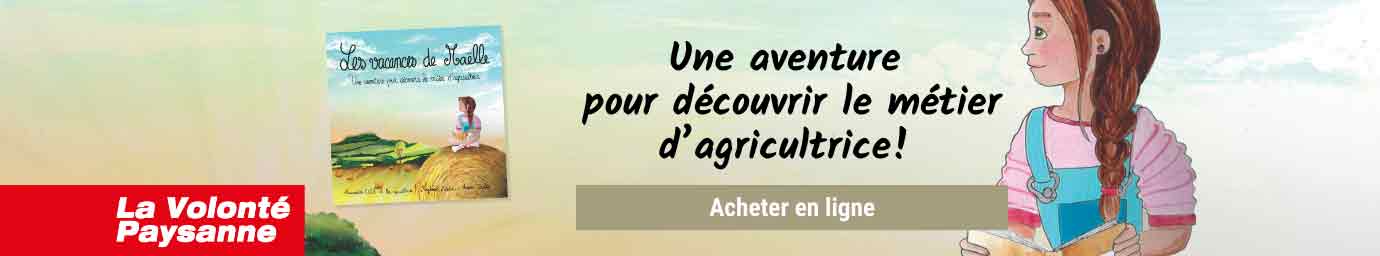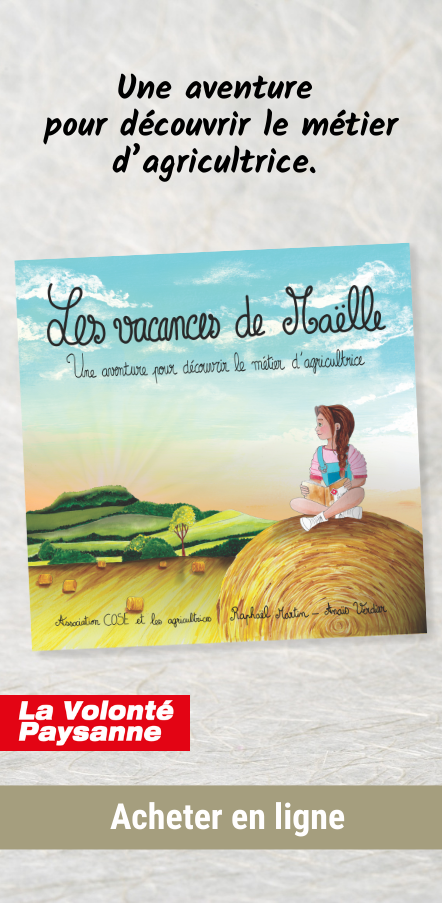Entre des effectifs en stagnation, des exportations en baisse et le développement de l’engraissement en France, «les broutards français sont très demandés à l’échelle européenne», note l’Institut de l’élevage dans son
bulletin Tendances le 22 novembre. Résultat : des cours «en hausse faute d’offre suffisante», de +40 à +70 ct€/kg en un an, selon les catégories d’animaux, pour des cotations allant de 3,83 à 4,2 €/kg en semaine 46 (du 11 novembre). Dans les élevages, alors que la décapitalisation se poursuit, les effectifs de mâles sont stables pour les charolais (premiers en nombre de têtes) et en baisse pour les limousins, blonds d’Aquitaine et croisés. Or, l’engraissement de broutards se développe dans l’Hexagone, «aux dépens de l’export», observe l’Idele: depuis le début de l’année (1
er janvier-20 octobre), les exportations de broutards ont reculé de 7% sur un an (à 749 000 têtes). Et dans les mois à venir, les broutards français devraient se faire encore plus rares : les effectifs d’animaux de moins de six mois sont «en forte baisse» (-8% sur un an au 1
er octobre). La tendance aux vêlages d’automne «ne s’est pas poursuivie en septembre 2024», constate l’Idele, (-9% en septembre sur un an), probablement en raison des maladies vectorielles (MHE et FCO).
Elisa Llop