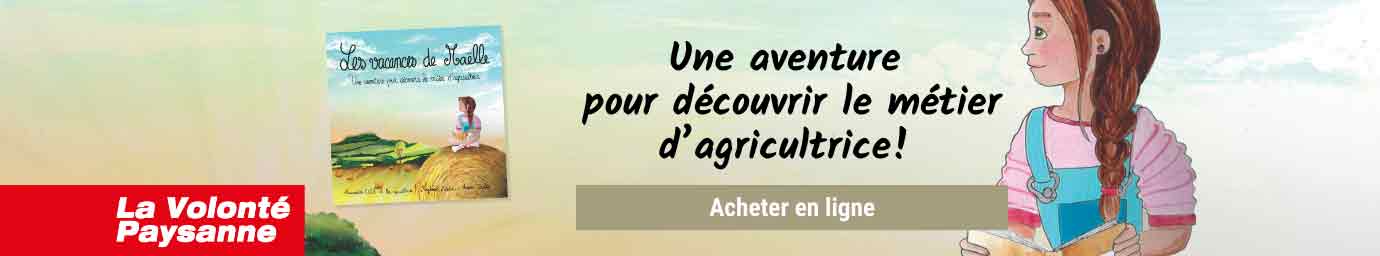Le 3 septembre, la Commission européenne a donné son feu vert lors d’une réunion du Collège des commissaires, au projet d’accord controversé entre l’UE et le Mercosur. Cette adoption lance à présent officiellement le processus de ratification. Très attendue sur la question de l’architecture juridique, Bruxelles a finalement choisi le même schéma que celui utilisé pour la modernisation de l’accord d’association UE/Chili signé en 2023. Celle-ci prendra la forme d’un accord de partenariat global et d’un accord commercial intérimaire avec pour objectif une mise en œuvre plus rapide des dispositions commerciales qui suscitent des inquiétudes dans le secteur agricole. Au niveau juridique, l’accord commercial intérimaire, contrairement à celui de partenariat global, ne nécessite pas la ratification individuelle des États membres. Celui-ci pourra donc entrer en vigueur après avoir obtenu la validation du Conseil de l’UE à la majorité qualifiée (55 % des États membres représentant 65 % de la population de l’UE) puis le consentement du Parlement européen à la majorité simple. « L’architecture juridique est alignée sur les traités », précise un haut fonctionnaire européen alors que certains eurodéputés envisagent de saisir la Cour de justice de l’UE sur cette question. Avec cette nouvelle étape, la balle est à présent dans le camp des Etats membres et des eurodéputés. De son côté, la Commission européenne reste confiant quant à la possibilité de signer l’accord d’ici la fin de l’année.

Un instrument sur les sauvegardes prévu
Parallèlement au lancement du processus de ratification de l’accord de partenariat UE/Mercosur, la Commission européenne a également annoncé le 3 septembre, la présentation d’un acte juridique spécifique distinct ayant pour but de rendre opérationnelles les dispositions en matière de sauvegarde pour les produits les plus sensibles. Ce texte, qui devra être traduit sous forme législative et adopté selon la procédure ordinaire, est un engagement politique de la Commission européenne en réponse aux préoccupations exprimées par le secteur agricole et certains Etats membres comme la France.
Concrètement, elle s’engage à superviser les marchés pour les produits les plus sensibles et à fournir tous les six mois un rapport sur la situation au Conseil de l’UE et au Parlement européen. En outre, Bruxelles s’engage à agir plus rapidement concernant le déclenchement des mesures de sauvegarde. Un texte qui a été salué par Paris. La porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, s’est d’ailleurs réjouie que l’UE «ait entendu les réserves» françaises tout en reconnaissant avoir «besoin d’analyser cette clause de sauvegarde». Au-delà des sauvegardes, la Commission européenne considère avoir mis en œuvre «ceinture et bretelles» pour préserver le secteur agricole, citant notamment le filet de sécurité de 6,3 milliards d’euros (doublement de la réserve agricole) prévu dans la proposition de cadre financier pluriannuel 2028-2034 et l’alignement des normes de production compris dans la Vision pour l’agriculture et l’alimentation.
Réactions contrastées
Malgré les tentatives de l’exécutif européen pour rassurer, l’annonce de l’adoption de l’accord commercial UE/Mercosur, le 3 septembre, a recueilli des réactions contrastées tant chez les représentants professionnels de l’agroalimentaire que chez les Etats membres ou les eurodéputés. Si le Copa-Cogeca (syndicat majoritaire européen) avait prévenu en amont quant au «passage en force politique» de la Commission européenne sur ce sujet, il a été rejoint par la Cibe (betteraviers européens) qui appelle au rejet de l’accord. A contrario, le secteur européen des boissons alcoolisées, SpiritsEUROPE (spiritueux) et le CEEV (entreprises vins), particulièrement touchés par les surtaxes américaines, voient en ce traité une opportunité d’étendre leurs marchés. Parmi les Etats membres, si la position de la France sur ce sujet pourrait être amenée à évoluer, l’Espagne (en faveur) et la Pologne (contre) maintiennent les leurs.
Au Parlement européen, l’appartenance à un groupe politique n’est pas un gage de réaction uniforme. C’est notamment le cas chez les centristes de Renew où le Français Pascal Canfin et le Belge Yvan Verougstraete évoquent la possibilité d’un recours juridique contre l’accord, au même titre que la Française Manon Aubry (la Gauche), tandis que leur groupe politique salue le début du processus de ratification formelle.
Si la ministre de l’agriculture, Annie Genevard, admet que la Commission a «tenu compte des intérêts des agriculteurs français» en incluant «à l’initiative de la France» une clause de sauvegarde renforcée «pour protéger nos filières sensibles», elle se montre peu enthousiaste face à cet accord. «Notre position reste ferme, la défense de notre agriculture n’est pas négociable», prévient Annie Genevard. Elle indique que les «garanties nouvelles» devront «être pleinement opérationnelles, applicables sur le terrain», mais aussi «accompagnées de mesures-miroir et d’un véritable renforcement des contrôles sanitaires et phytosanitaires». «Le combat continue», promet-elle.
De son côté, les syndicats agricoles ont tous dénoncé l’accord. La FNSEA et les JA le qualifient de «toxique», la CGB (betteraviers) estime que «Bruxelles souffle sur les braises de la colère des betteraviers».
Source Agra