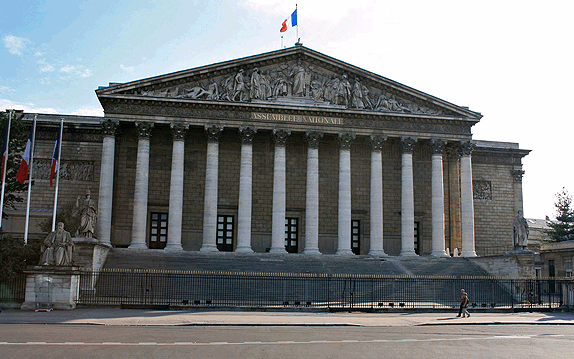National | Par La rédaction
Dans le cadre du salon de l’agriculture, la FNSEA a organisé une table ronde sur la restauration collective. Intitulée «Restauration collective : entre engagements et défis pour la valorisation d’une agriculture durable sur nos territoires», le débat a réuni plusieurs acteurs de ce secteur.

Photo source Actuagri
Le secteur de la restauration collective rassemble plus de 81 000 structures qui servent 3,6 milliards de repas par an pour un chiffre d’affaires de près de 24 milliards d’euros. 90 % des approvisionnements sont réalisés par les grossistes. Ce mode de restauration intervient dans de nombreux secteurs : la santé et le social (48 % du total), l’enseignement (33 %), le travail (9 %), la pénitentiaire (5 %) et les loisirs (4 %). Le secteur connaît deux modes de gestion : l’autogestion et la concession. «Il n’y a pas une restauration collective, mais des restaurations collectives», a confirmé Frédérique Lehoux, directrice générale de GECO Food Service, association qui regroupe différents fournisseurs alimentaires du secteur de la restauration. «Cette restauration a besoin de volumes disponibles dans la durée», a-t-elle ajouté en insistant sur la «nécessité de la complémentarité de gammes dans les assiettes». Elle a déploré «la complexité» des objectifs des lois Egalim. «Ce cadre unique a été pensé sans les moyens accordés. On a besoin d’une politique d’achats publics», a-t-elle insisté. Elle a rappelé ces objectifs d’Egalim : depuis le 1er janvier 2024, toutes les restaurations collectives doivent atteindre ces objectifs : 50 % minimum du budget d’achat dédié à l’achat de produits durables et de qualité, dont 20 % minimum de budget d’achat dédié à l’achat de produits bio. Des objectifs loin d’être atteints.
Elus en soutien
C’est l’enseignement qui est le meilleur élève avec 30 % des achats en produits durables et de qualité, dont 17 % en bio (en 2023, derniers chiffres disponibles). Et le milieu de la santé (hôpitaux…) respecte le moins l’obligation Egalim avec respectivement avec 14 % et 4 % de produits conformes à la loi. «Il faut arriver à faire des objectifs d’Egalim quelque chose de lisible et de pratique», a ajouté Sylvie Dauria, présidente de Restau’Co. Brice Guyau, président de la Commission bio de la FNSEA, a insisté sur le fait que «le bio ne doit pas être mis de coté. La restauration collective doit être le premier acteur pour faire redémarrer cette filière. Plus le consommateur est habitué à avoir des produits bio, plus il sera incité à en demander». D’où l’importance d’une «réelle application» des lois Egalim en restauration. «Il faut que nos produits arrivent dans l’assiette», a complété Anne-Marie Denis, vice-présidente de la commission alimentaire de la FNSEA. «Il faut arriver à faire rentrer nos produits durables dans la restauration collective. Les élus doivent être des acteurs à nos cotés». Elle a par ailleurs insisté sur «la valeur de l’alimentation. Laisser croire qu’un repas en cantine coûte 0,5 ou 1 euro, c’est de la destruction de valeur». Il faut expliquer que «ces repas sont soutenus, subventionnés», a-t-elle suggéré. «La restauration collective doit prendre toute sa place dans son rôle de soutien à la souveraineté alimentaire», a conclu Jordy Bouancheau de Jeunes Agriculteurs. Il est nécessaire «de démarrer le dialogue avec ceux qui n’atteignent pas les objectifs Egalim, pour les inciter à aller plus loin».
La rédaction