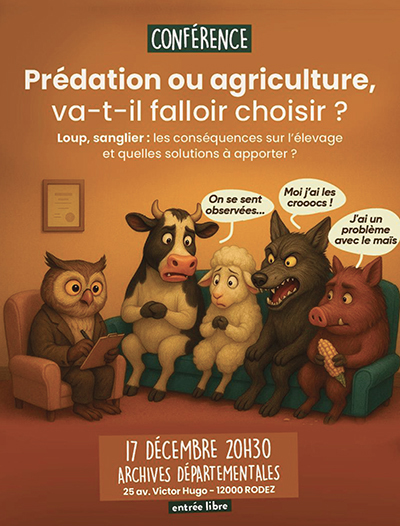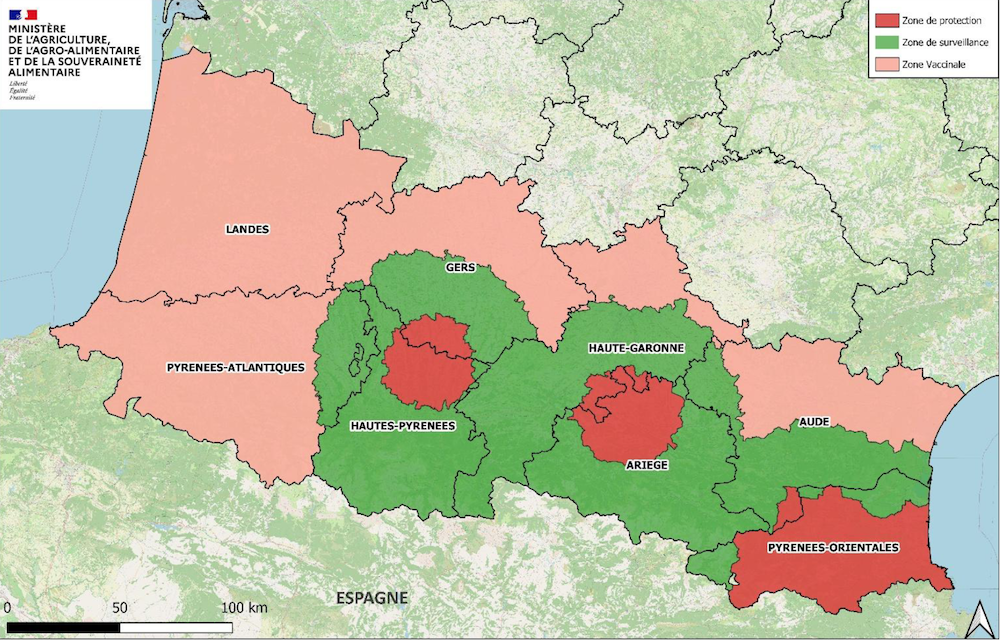Dans une note d’actualité diffusée le 26 octobre, l’Association nationale des industries alimentaires (ANIA) s’inquiète des appels au boycott des produits alimentaires français. Bien qu’il soit encore trop tôt « pour évaluer les conséquences économiques », l’ANIA souligne que le marché du Proche-Moyen Orient représente 3 % des exportations du secteur. Elle craint surtout que le recul enregistré en 2019 sur cette partie du monde ne s’aggrave. En effet, selon les chiffres du service des Douanes, les exportations françaises ont globalement reculé de 9 % vers le Moyen-Orient. Chaque année, la France exporte, tous produits industriels confondus, 11,516 milliards d’euros (Md€) vers la zone Proche-Moyen Orient dont 1,3 Md€ de produits alimentaires. Parmi eux, des produits laitiers et fromages (249 millions d’euros-M€), du vin (137 M€), des aliments homogénéisés et diététiques (121 M€), des viandes de volailles (113 M€) et des boissons alcoolisées (108 M€). « Mobilisée auprès de la cellule de crise mise en place par le ministre délégué au Commerce extérieur » et « solidaire avec les déclarations gouvernementales », l’ANIA est « extrêmement vigilant[e] sur l’étendue et l’impact pour les entreprises », indique la note d’actualité.
Didier Bouville