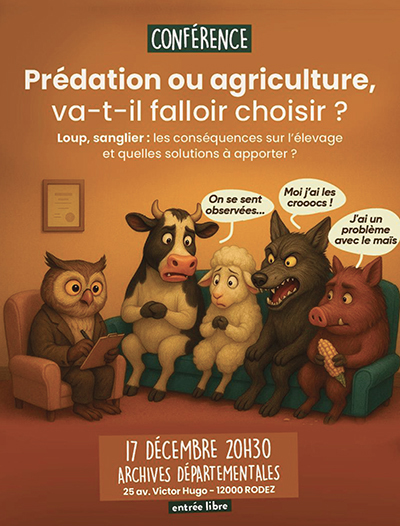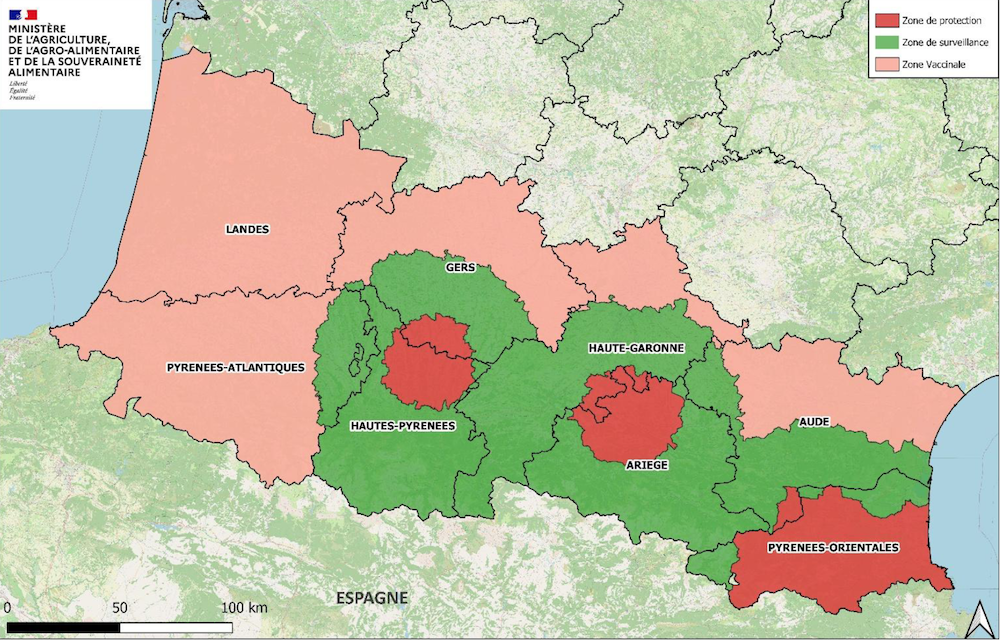Après plusieurs années de désaccord, la Section des fermiers et des métayers de la FNSEA (SNFM) a annoncé le 27 février, à quelques jours de son congrès le 5 mars, que les discussions sur le statut du fermage avec la section des propriétaires ruraux (SNPR) ont abouti en février. Sur six propositions de la SNFM, deux restaient en discussion et viennent de faire l’objet d’un accord: la transmission de l’entreprise du fermier sortant et la subrogation du droit de préemption du fermier. Les deux sections peuvent maintenant présenter un socle commun aux parlementaires dans le cadre des discussions sur la future loi foncière. Sur la transmission, l’objectif est de transmettre plus facilement une ferme en instituant le fait qu’un fermier cédant propose à son bailleur un repreneur et le lui présente, qu’il s’agisse de son descendant ou bien d’un tiers, trop de bailleurs déplorant de n’être informés que par lettre recommandée. Les conditions de reprise seront alors discutées entre le nouveau preneur et le fermier sortant. Sur la subrogation du droit de préemption du fermier, en cas de vente du bien loué, la SNFM propose d’élargir les possibilités par lesquelles le fermier, qui n’a pas les moyens d’acheter, fait bénéficier de son droit de préemption un membre de sa famille ou un tiers pour que ce dernier achète la terre que lui, fermier, continuera d’exploiter.
Didier Bouville