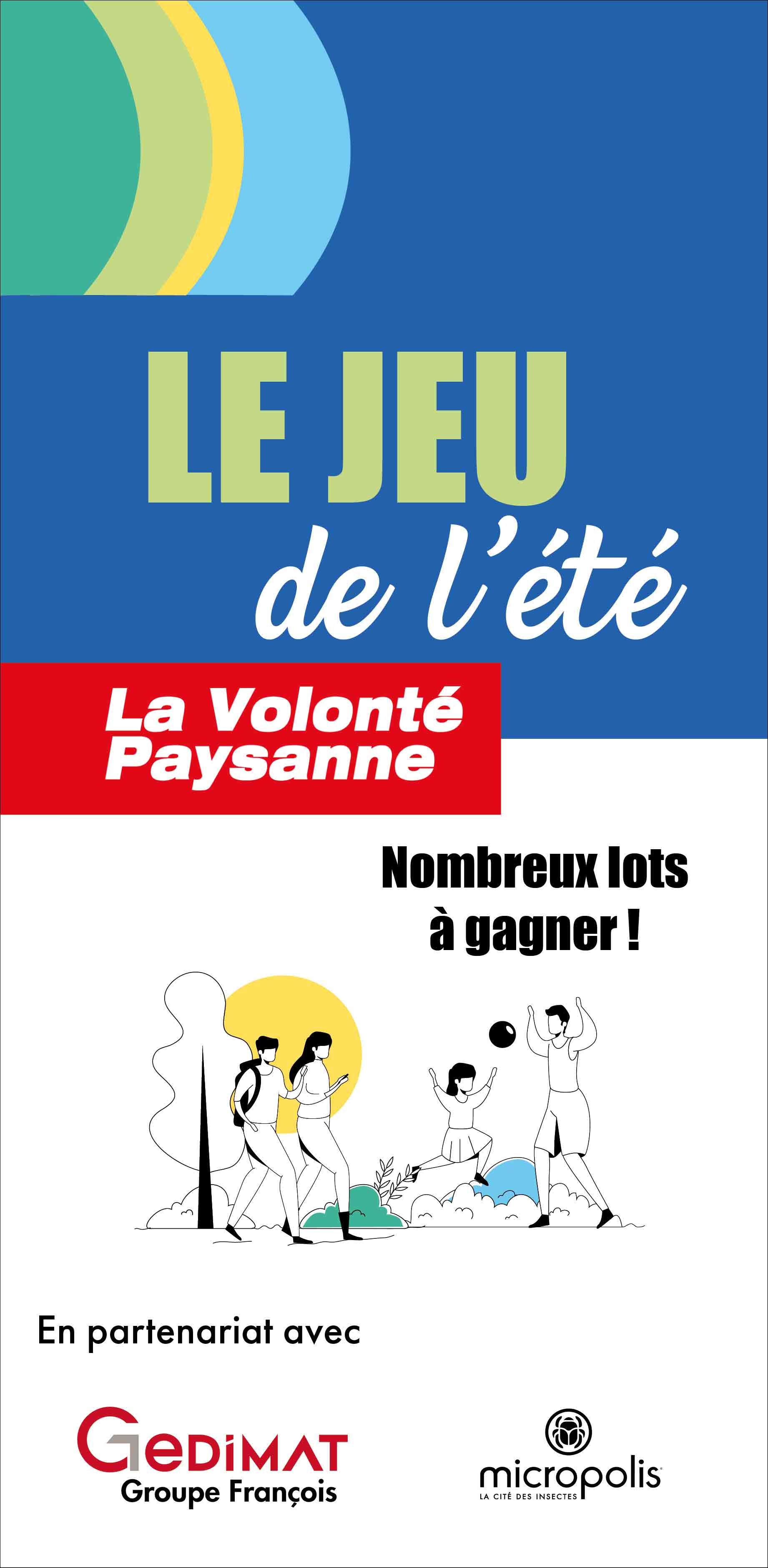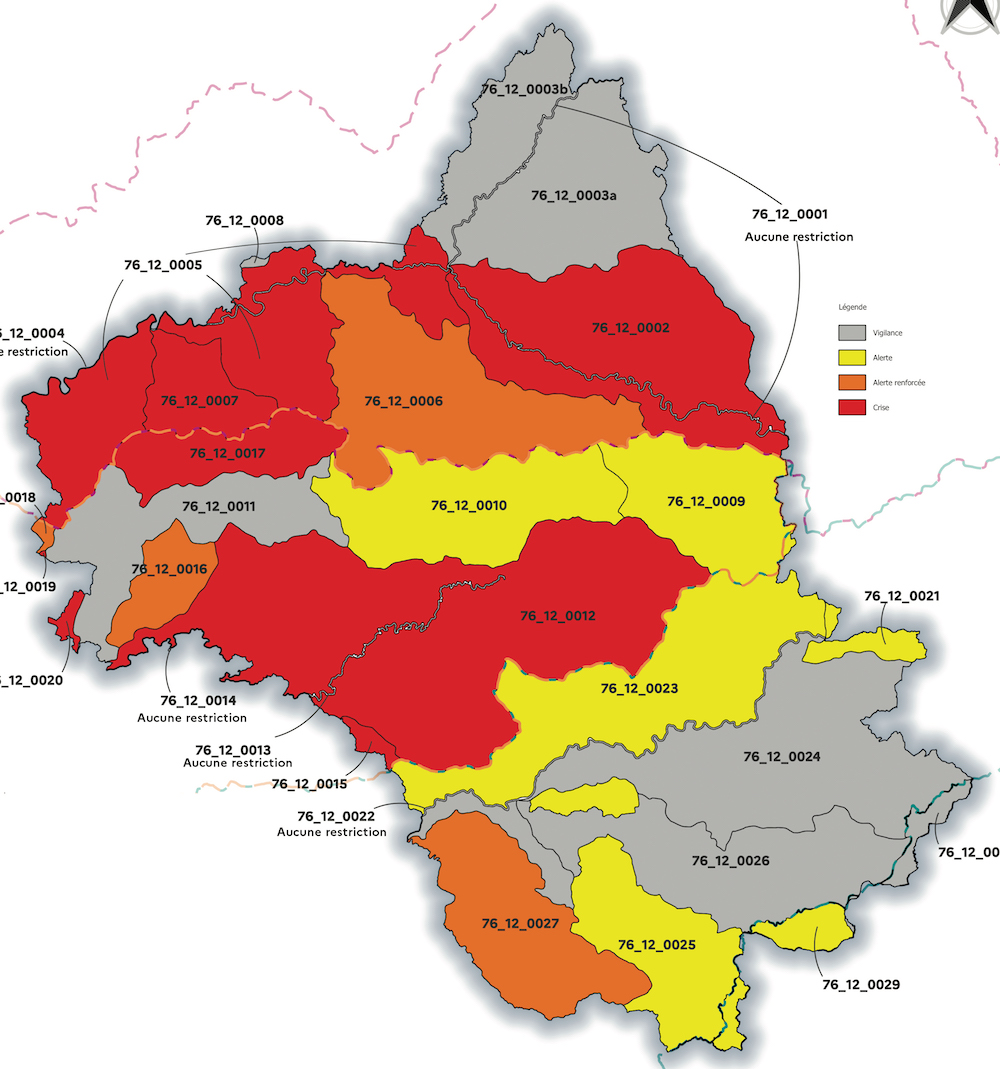Le groupe coopératif Fipso a proposé de racheter le pôle Salaisons de Maïsadour, formé de Delpeyrat-Chevallier et Salaisons pyrénéennes, d’après une notification reçue le 17 mars par l’Autorité de la Concurrence. Fipso «propose d’acquérir, sous condition suspensive, l’intégralité des titres des sociétés», peut-on lire sur le site web de l’Autorité, qui recueille actuellement les observations des tiers jusqu’au 7 avril. Delpeyrat-Chevallier et Salaisons pyrénéennes sont spécialisées dans les charcuteries crues, vendues «essentiellement à la grande distribution», précise l’Autorité. L’opération concerne «cinq sites industriels dans le Sud-Ouest de la France». Si elle se confirme, cette acquisition permettra à Fipso – qui «ne possède pas d’activité dans le secteur de la charcuterie à base de viande crue» selon l’Autorité – de mettre un pied dans le secteur des salaisons. Avec quelque 600 000 porcs par an, le groupe coopératif est leader du secteur dans le Sud de la France. Il est présent dans l’élevage, la collecte, l’abattage, la découpe, les produits élaborés et l’exportation.
Didier Bouville