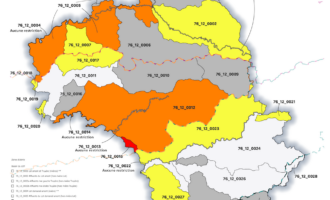Par Agra
Eau/captages: des scientifiques et économistes pointent «l’inaction» du gouvernement
Des scientifiques et des économistes reprochent aux autorités leur «inaction» dans la préservation de l’eau, dans deux tribunes publiées le 11 février, à la veille de l’examen d’une proposition de loi écologiste pour protéger les captages des pesticides. «Suspendre les politiques de protection de l’eau revient à choisir d’aggraver les contaminations et l’incidence des maladies qu’elles engendrent», estiment dans une tribune au Monde plusieurs scientifiques, dont Laurence Huc, directrice de recherche à l’Inrae, ou les toxicologues de l’Université Paris Cité, Sylvie Bortoli et Xavier Coumoul. Cette prise de position intervient alors que le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé un «moratoire sur toutes les décisions relatives» à la question de l’eau. Il faut «au minimum, arrêter l’usage de pesticides de synthèse dans les aires d’alimentation des captages d’eau potable», jugent les scientifiques, pour qui «l’inaction est irresponsable et coupable pour les générations à venir». Même constat au sujet de la raréfaction de l’eau de la part d’économistes du Conseil d’analyse économique (CAE) dans une tribune publiée par Libération : «ce qui manque, ce n’est ni l’expertise, ni les outils, mais la volonté de les mettre réellement en oeuvre, alors même que le réchauffement climatique rend chaque année l’inaction plus coûteuse». «Quand des scientifiques alertent, nous devons les écouter», a réagi la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, dans une déclaration transmise à l’AFP.