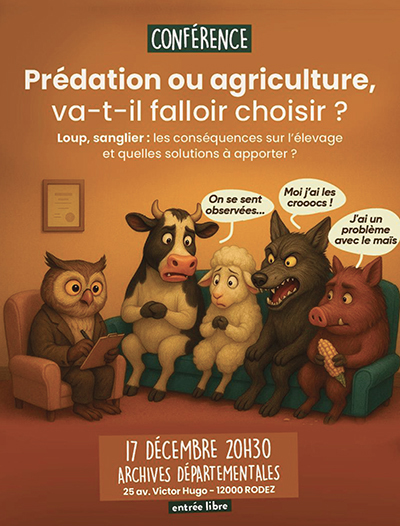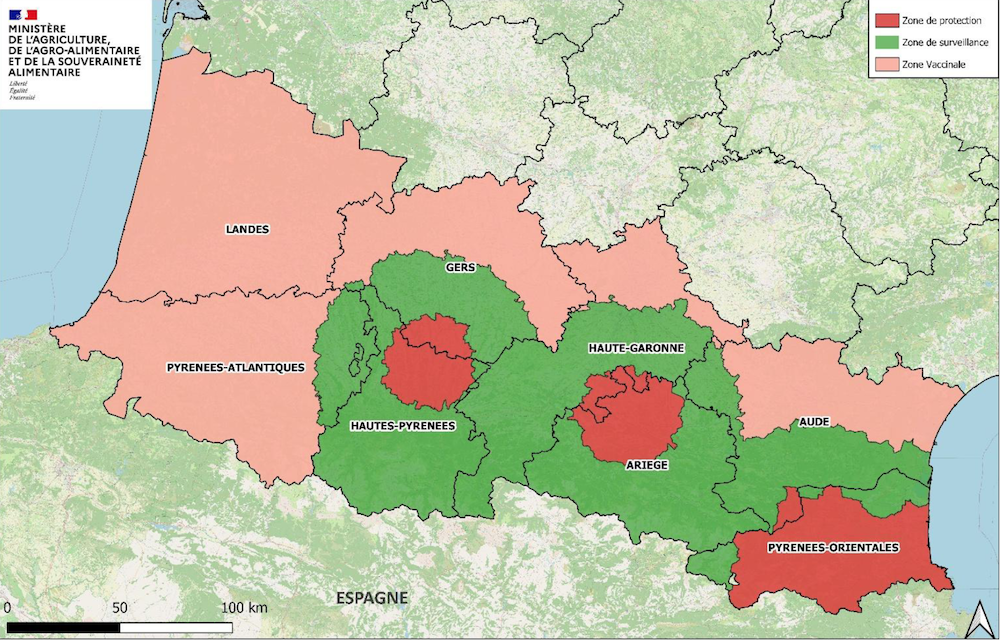Le Sénat a décidé mercredi 16 mai par 252 voix contre 22 de ne pas adopter la proposition de loi sur la revalorisation des pensions de retraites agricoles. Le gouvernement, comme le 7 mars dernier lors des premières discussions autour de ce texte devant l’Assemblée nationale, a une nouvelle fois demandé l’application de l’article 44-3 de la constitution dit de « vote bloqué », obligeant l’assemblée à ne se prononcer que par un seul vote en ne retenant que les amendements acceptés ou proposés par le gouvernement. « Aujourd’hui, c’est la quasi-unanimité de la majorité des groupes politiques, à l’exception de la République en marche, qui est bafouée et c’est la dignité des retraités agricoles qui est niée », a réagi le groupe CRCE au Sénat qui portait cette proposition de loi du député communiste André Chassaigne.
Didier Bouville