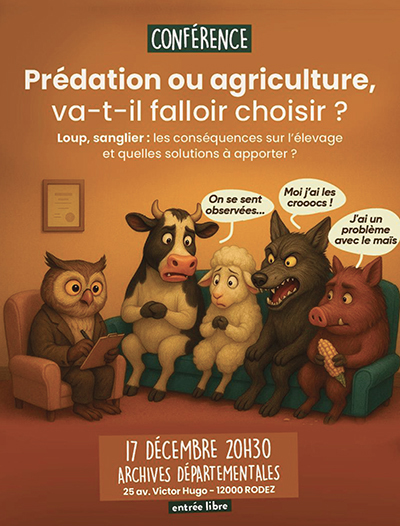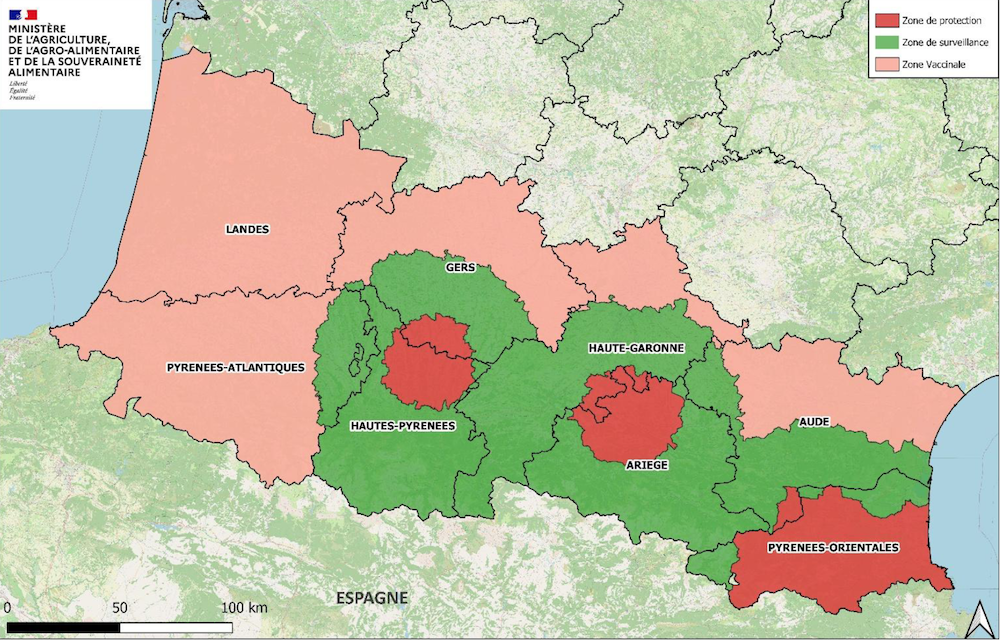Les partenaires sociaux se sont mis d’accord, le 15 juin, pour augmenter de 2,45 à 2,65% les salaires minimaux de la branche production agricole et CUMA, d’après les informations de la FNSEA. La nouvelle grille a été publiée par l’association spécialiste Légumes de France dans sa dernière lettre hebdomadaire. Cette négociation intervient après que le SMIC est passé à 10,85€, soit une augmentation de 2,65%, au 1er mai 2022. Il s’agit de la troisième augmentation depuis l’automne des salaires minimaux de la branche production agricole et CUMA : +2,2 à +2,5% en octobre et 0,9 à 1% en janvier. La délégation patronale a «tenu à garder une grille de salaires attractive tout en prenant en considération les difficultés économiques des entreprises agricoles», explique la FNSEA. L’application légale de ces nouveaux minimums est suspendue à la parution d’un arrêté d’extension de l’accord au Journal officiel, mais «dans le contexte de tension sur le pouvoir d’achat, la FNSEA invite les employeurs à appliquer dès à présent cette nouvelle grille de salaires», indique le syndicat.
Eva DZ