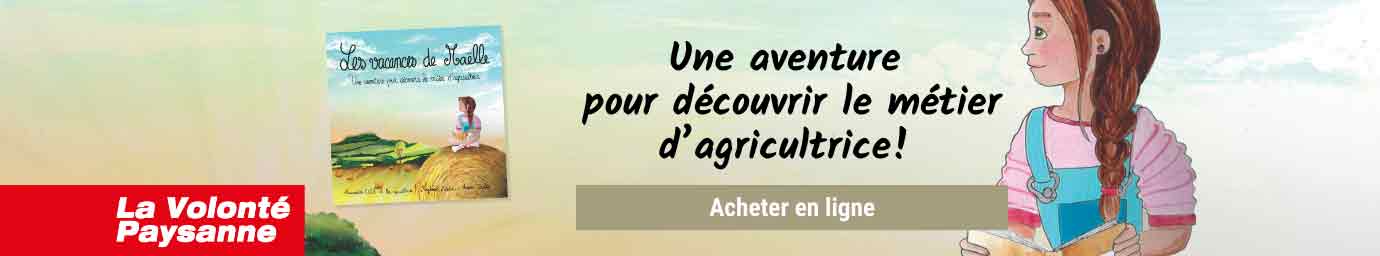Dans une note sur l’évolution des résistances aux fongicides sur céréales à paille parue le 6 février, Arvalis, Inrae et l’Anses dressent un état des lieux par maladie et par mode d’action. Face à une progression des souches résistantes, les instituts recommandent de «n’intervenir que si strictement nécessaire» et encouragent, en premier lieu, le recours «à la prophylaxie, aux variétés résistantes et aux outils d’aide à la décision». Pour minimiser la pression de sélection, la priorité est de diversifier les modes d’action au sein des programmes, sachant que, «sur blé comme sur orge, l’utilisation des SDHI doit être limitée à une seule application par saison». Sur blé, face à la progression des résistances multiples, il convient de «privilégier les fongicides multisites et les spécialités de biocontrôle». Sur orge, pour éviter de sélectionner davantage les souches présentant une résistance multiple, «le recours à l’utilisation d’un mélange trois voies QoI+SDHI+IDM doit être rigoureusement limité aux situations où l’helminthosporiose est très difficile à contrôler». Enfin, pour gérer les rouilles des céréales, le conseil est d’éviter de recourir aux SDHI, mais d’opter de préférence pour les traitements associant triazoles et Qol. (Anne Gilet)