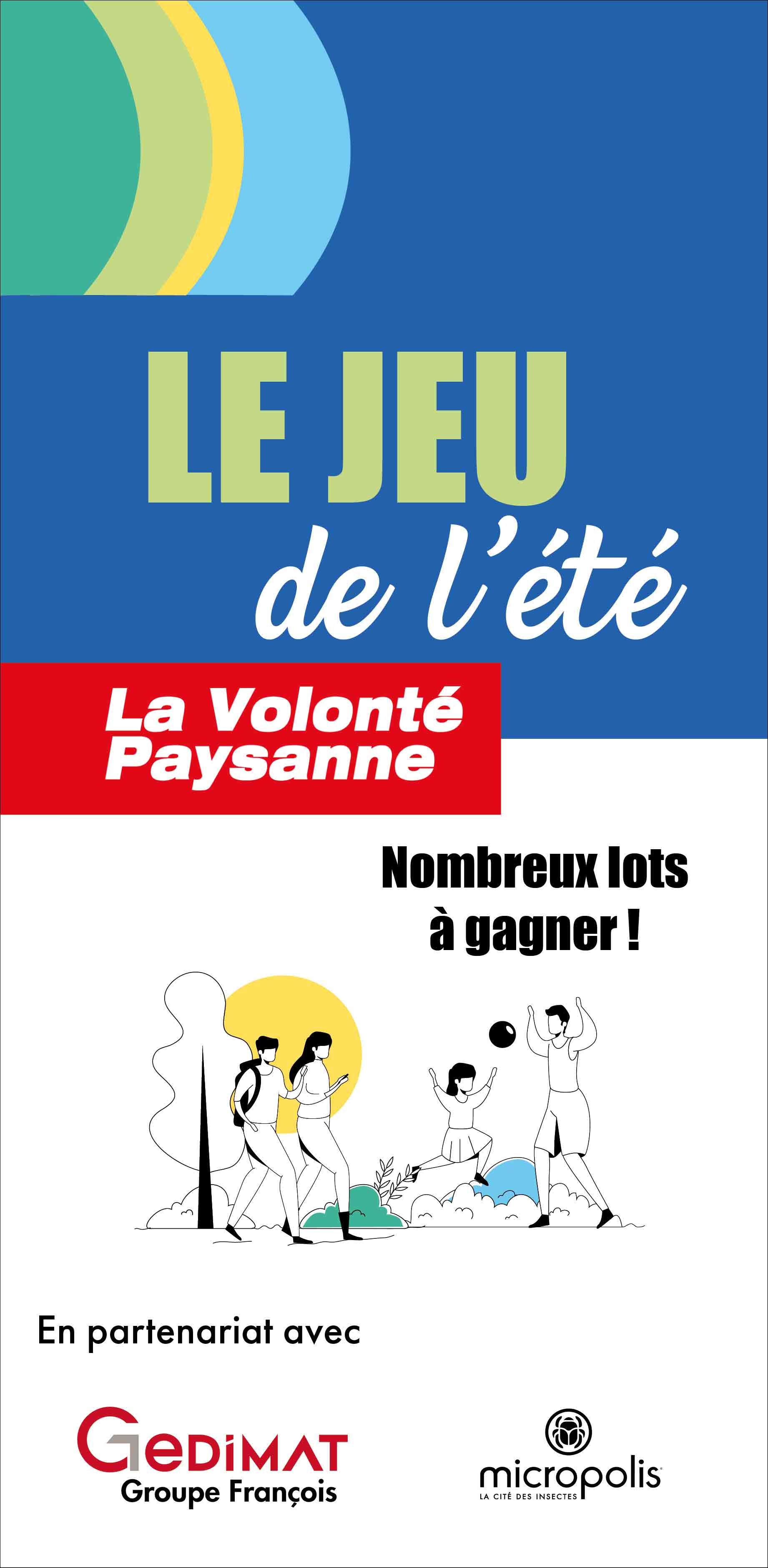Par Agra
Engrais azotés minéraux : pas assez d’engrais organiques en France pour s’y substituer
Selon une étude de FranceAgriMer (FAM) publiée le 20 juin, sur la substitution des engrais azotés minéraux, les disponibilités en engrais organiques azotés en France ne seraient pas seules suffisantes pour répondre aux besoins des agriculteurs. L’organisme public en distingue trois principaux types : digestats issus de méthaniseurs, effluents d’élevage, urine humaine. L’épandage combiné de ces produits couvrirait seulement 24 % des besoins hexagonaux en azote efficace, soit 477 739 tonnes, d’après FAM. Ainsi, la France devra poursuivre ses importations d’engrais minéraux azotés, et continuera de dépendre des prix internationaux du gaz et des aléas géopolitiques. Néanmoins, développer une production d’engrais organiques et minéraux combinés est indispensable pour décarboner l’agriculture et réduire sa dépendance à l’extérieur, indique l’étude. Sachant que les disponibilités en engrais organiques à base de phosphore et de potassium seraient de leur côté suffisantes pour satisfaire la demande de l’agriculture hexagonale, couvrant respectivement 104 % (160 035 t) et 221 % des besoins (734 113 t).