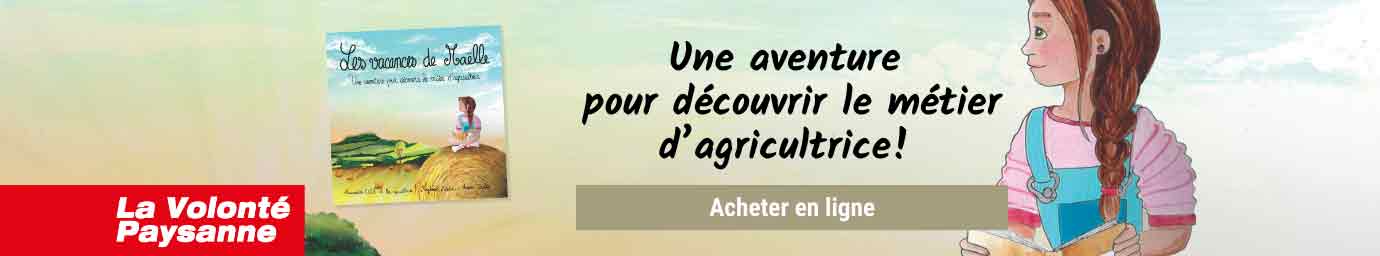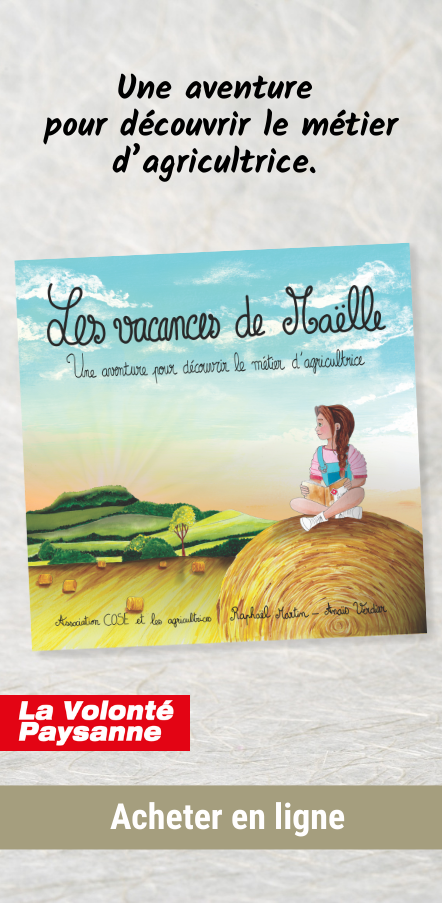Lors d’une réunion avec Gabriel Attal et Marc Fesneau le 13 février, «nous avons dit que nous voulons voir des sujets de compétitivité [dans le projet de loi d’orientation] en plus de l’installation/transmission», a indiqué le président de la FNSEA Arnaud Rousseau, lors d’une conférence de presse le même jour. «Des propositions ont été faites par les sénateurs» (notamment du groupe LR), «nous aussi, nous avons des propositions», a-t-il ajouté, sans s’étendre sur le sujet. Initialement centré sur le renouvellement des générations (installation/transmission et formation), le projet de loi d’orientation agricole (PLOA) s’est vu ajouter deux volets à l’issue des manifestations de fin janvier, l’un sur la simplification (réduction des délais de contentieux, présomption d’urgence, etc.) et l’autre sur la souveraineté alimentaire (inscription dans le Code rural, etc.). Le texte devrait être soumis au Conseil d’État «avant la fin du mois de février, c’est-à-dire entre la fin de cette semaine et le début de la semaine prochaine», a indiqué le cabinet du ministre de l’Agriculture à la presse le 12 février. Avant cette étape, «les ministres (Fesneau et Pannier-Runacher, NDLR) verront dans la semaine chacune des OPA pour échanger» sur le contenu de la loi.
Didier Bouville