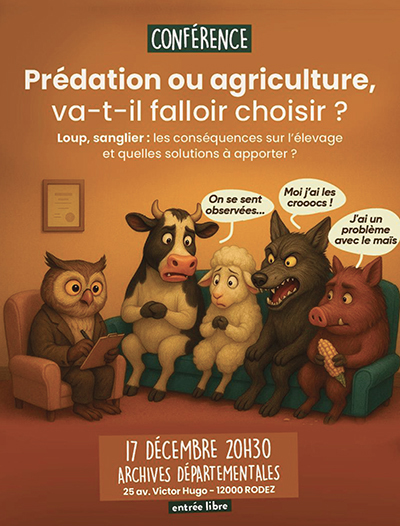Lors du Conseil des ministres de l’Agriculture de l’UE le 13 mai, le ministre français Didier Guillaume a «annoncé au nom du gouvernement que la France était opposée à l’utilisation de la réserve de crise». C’est ce qu’il a rapporté lors de son audition, le même jour, devant les députés de la commission des Affaires européennes. Les fonds de cette réserve sont «directement pris sur le premier pilier», a fait valoir le ministre. «Or, nous dépensons totalement le premier pilier, cela veut donc dire faire baisser les aides directes aux agriculteurs pour leur redonner des aides. Ça n’a pas de sens.» Paris s’est dit favorable à une réserve de crise dotée d’un «budget à part», «indépendant des paiements directs».
Par ailleurs, Didier Guillaume a estimé que les mesures d’intervention sur les marchés adoptées par Bruxelles le 4 mai sont «loin du compte». Lors du Conseil des ministres européens, le locataire de la Rue de Varenne a demandé à «aller plus loin» en actionnant les aides au stockage privé pour le veau, les volailles et la pomme de terre de transformation. Il a également plaidé pour des mesures de soutien aux filières viticole (face au Covid-19 et à la taxe Trump), brassicole et cidricole, ainsi qu’un «mécanisme spécifique pour l’horticulture».
Didier Bouville