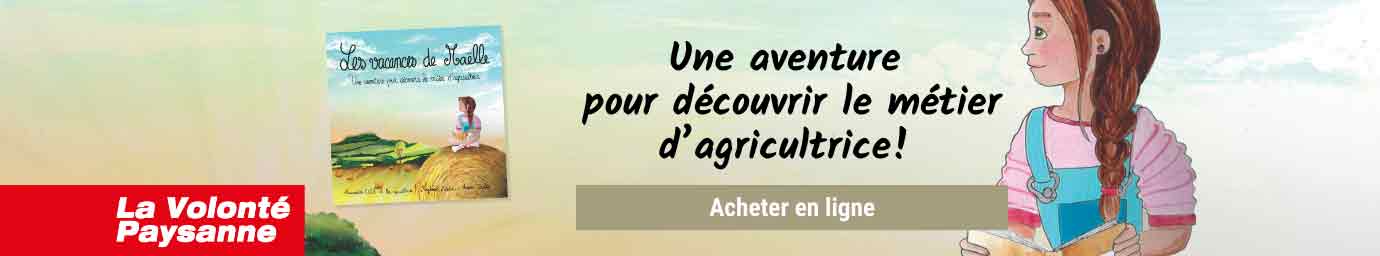Par La rédaction
Eau : dans un état critique alors que Bruxelles prépare sa stratégie de résilience
L’état des masses d’eau de l’UE ne s’améliore pas, voire empire, déplore dans un rapport publié le 4 février, la Commission européenne. En effet, en 2021, seulement 39,5% des eaux de surface en Europe étaient en bon état écologique (contre 39,1% dans le précédent rapport portant sur 2015) et seulement 26,8% en bon état chimique (contre 33,5% en 2015). L’agriculture est citée comme l’une des principales sources de pression sur la ressource hydrique que ce soit pour les eaux de surfaces ou (plus encore) les eaux souterraines. Ces données alimenteront les réflexions que mène Bruxelles en vue de la présentation d’une stratégie sur la résilience en eau (traitant à la fois des aspects qualitatif et quantitatif) attendue avant l’été. La Commission a lancé, le même jour, un appel à éléments de preuves et elle organisera une rencontre avec l’ensemble des parties prenantes le 6 mars. Le Parlement européen aussi avance sur le dossier. Son rapporteur, le social-démocrate maltais Thomas Bajada, souligne dans un projet de résolution qui vient d’être publié l’importance de fixer des «objectifs sectoriels contraignants en matière d’efficacité et de captage de l’eau» pour l’agriculture notamment mais aussi l’industrie et l’usage domestique, «adaptés aux évaluations à l’échelle du bassin».