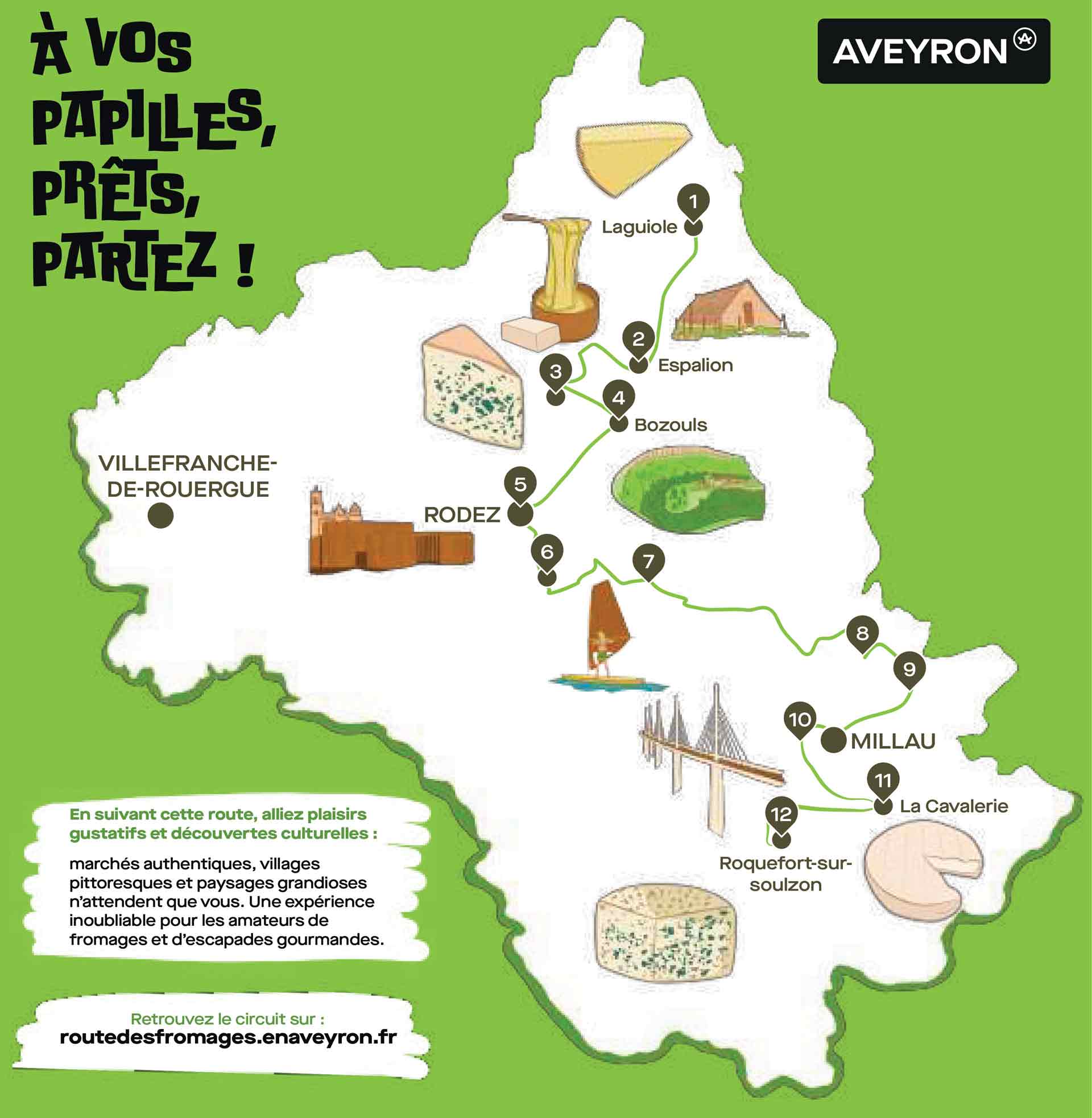À la demande du ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari en séance le 22 juin, les sénateurs ont démarré l’examen du titre V de la loi climat concernant le secteur agroalimentaire avant le titre IV. Lors de ce débat, malgré un avis défavorable du ministre de l’Agriculture, les sénateurs ont adopté un amendement du groupe socialiste et écologiste demandant un rapport sur le développement des paiements pour services environnementaux (PSE). Ce rapport devra évaluer les programmes en cours, et notamment ceux menés avec les Agences de l’eau dans le cadre du plan biodiversité de 2018, afin de définir «une trajectoire en vue de la massification des paiements pour services environnementaux sur l’ensemble du territoire national».
«Le rapport devra préciser que le financement des PSE ne doit pas grever le budget de la Pac», a insisté la rapporteure LR Anne-Catherine Loisier en séance, en émettant un avis favorable. Amendant le texte de l’écologiste Joël Labbé exigeant un linéaire d’1,5 million de kilomètres de haies en France pour 2050, les sénateurs ont conservé une incitation sans objectif chiffré. Dans sa rédaction finale, le texte prévoit que «l’État veille à la promotion de la préservation et de l’implantation des haies et des alignements d’arbres intraparcellaires», ainsi que des prairies permanentes.
Didier Bouville