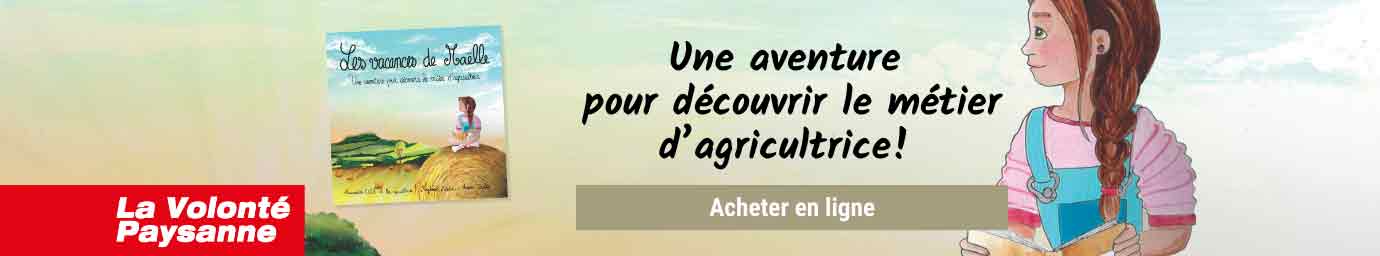Dans ses prévisions de production pour 2023 publiées le 20 janvier, l’Institut de l’élevage (Idele) remarque une «réorientation des broutards vers les engraisseurs français», au détriment de l’export en vif. Les jeunes bovins sont la catégorie d’animaux dont la production baisserait le moins en 2023 (-0,9%, à 349 000 téc), alors que les broutards sont ceux qui reculeraient le plus (-3%, à 1,03 million de têtes). Toutes catégories confondues, la production de viande bovine est attendue en chute de 1,6% en 2023 (à 1,337 Mtéc). Une troisième année de baisse consécutive, après un effondrement de 4,7% en 2022. Cette année, «la demande pour l’engraissement en France sera (…) relativement dynamique», prévoit l’institut technique. Et l’Idele de noter de «nombreuses initiatives (…) à l’œuvre pour contrecarrer la baisse de production», citant notamment le «développement de la contractualisation» en jeunes bovins. Les exportations de broutards pâtissent de cette orientation, cumulée à la décapitalisation (-3% de cheptel allaitant en 2022), qui se traduit par une baisse des naissances. D’ici 2030, ce recul du cheptel devrait provoquer une baisse «quasi inéluctable» des broutards disponibles, alertait Interbev (interprofession bétail et viandes) au Sommet de l’élevage 2022.
Didier Bouville