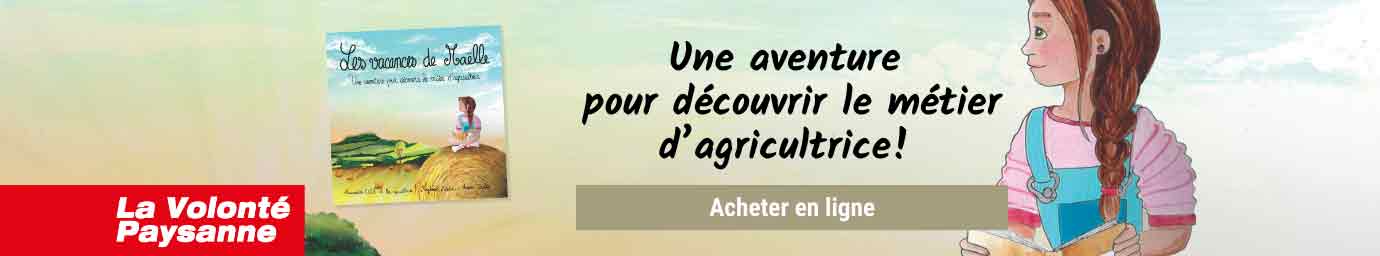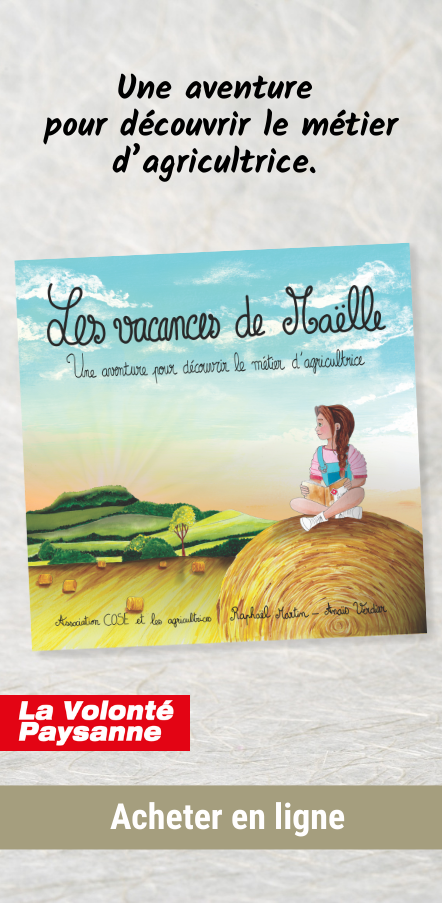Le cahier des charges de la dénomination miel des Landes a été homologué par les ministères de l’Economie et de l’Agriculture, selon un arrêté paru au JO le 23 août. Le dossier doit maintenant être transmis à la Commission européenne qui étudiera la demande d’enregistrement en tant qu’indication géographique protégée (IGP). Sollicitée par le syndicat des miels des Landes, cette homologation avait eu le feu vert de l’Inao à la fin du mois de mai. Le miel des Landes peut être monofloral (acacia, arbousier, bourdaine, bruyère cendrée, callune, châtaignier) ou polyfloral, indique le cahier des charges. Il provient de ruchers implantés dans le département des Landes et dans quelques dizaines de communes situées en Gironde et dans le Lot-et-Garonne. En revanche les phases d’extraction, de stockage et de conditionnement peuvent être réalisées en dehors de ces aires géographiques. Trois régions disposent déjà d’une IGP pour leur miel: l’Alsace, la Provence et les Cévennes.
Didier Bouville