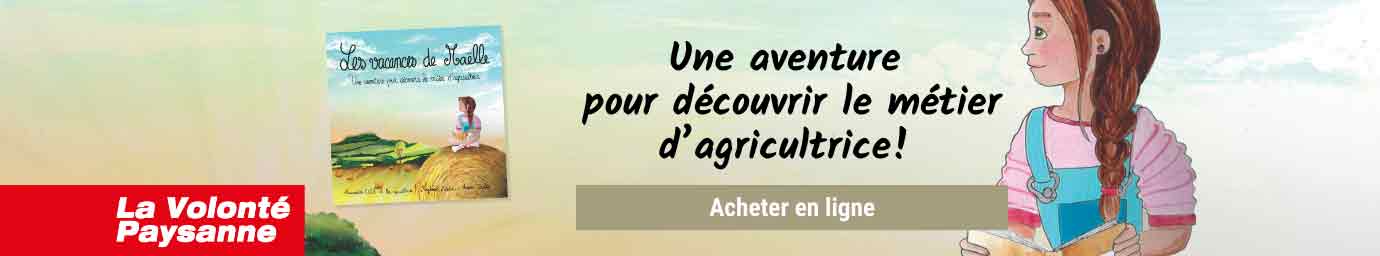À l’issue de réunions avec les agences de l’eau et les organisations professionnelles agricoles, les ministères de la Transition écologique et de l’Agriculture ont indiqué le 9 mai que le guichet « Troisième révolution agricole » ouvert en avril pour aider les agriculteurs à faire face au changement climatique, et initialement doté de 20 M€, allait être abondé « de 20 M supplémentaires ». Ce financement fait partie des 100 M€, annoncés le 1er février en clôture du Varenne de l’eau, pour des équipements et matériels innovants destinés à l’« agriculture économe en eau ». Le dispositif a connu « un franc succès », avec 17 M€ de demandes d’aides déposées « en quelques jours » sur notamment des projets d’investissements en vue d’optimiser la consommation d’eau, comme le pilotage de l’irrigation, l’utilisation de techniques d’irrigation plus performantes, selon le cabinet du ministre de l’Agriculture.
Face à la sécheresse, le gouvernement a par ailleurs annoncé le 9 mai une autre mesure consistant à « mobiliser l’ensemble des surfaces en herbe détenues au sein des camps militaires, le long des réseaux ferrés » ou par les établissements publics fonciers. Quinze départements sont en situation de « vigilance » ou d’« alerte » sécheresse, une situation qui « aura un impact sur la production de céréales », a-t-il indiqué.
Didier Bouville