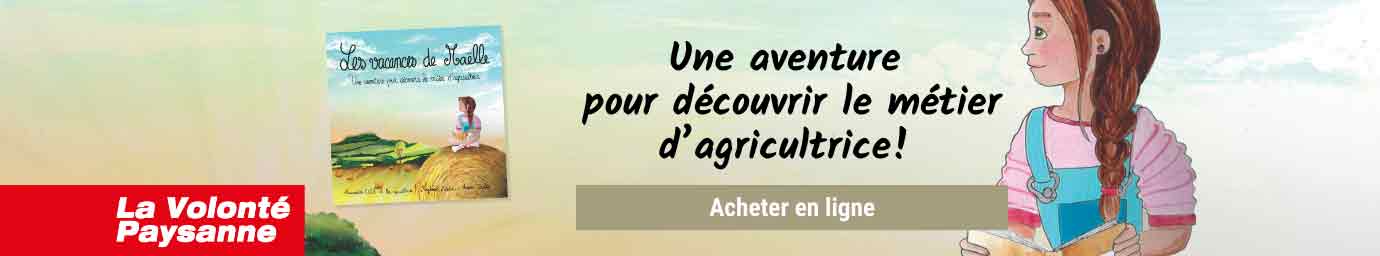En réponse à un arrêt du Conseil d’État du 15 novembre 2021, le gouvernement a soumis à consultation ce 16 mai un projet de décret autorisant les préfets à encadrer ou interdire les utilisations de pesticides dans les zones Natura 2000. Cette restriction des usages sera réservée aux cas où l’utilisation des pesticides «n’est pas effectivement prise en compte» dans les documents d’objectifs des parcs (Docob) et les contrats ou chartes qui en découlent. La FNSEA rappelle que de nombreuses zones Natura 2000 sont déjà dotées d’objectifs. Il s’agit «plutôt des aménagements sur les types de produits, ou des engagements à réduire les utilisations, que des interdictions pures et dures», détaille Christian Durlin, administrateur de la FNSEA en charge du dossier pesticides. Pour les territoires où le travail n’a pas encore été fait, «nous serons attentifs aux moyens dédiés à la compensation», prévient l’élu syndical, rappelant que «certaines MAE ne sont pas adaptées aux situations locales». mettant les préfets au centre du dispositif serait toutefois plutôt satisfaisante pour le syndicat majoritaire, en permettant «d’avoir des mesures adaptées localement, notamment aux objectifs des directives oiseaux et habitats». La consultation se clôture le 5 juin prochain.
Natura 2000+pesticide
Didier Bouville