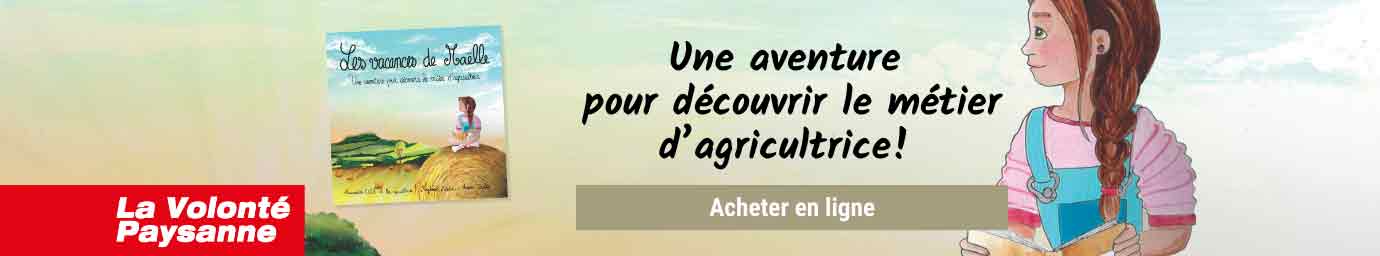Par Agra
Glyphosate : une influente étude en faveur de son inocuité retirée après des années d’alertes
Une influente étude affirmant que le glyphosate ne présente aucun risque grave pour la santé a été récemment retirée pour suspicion de conflits d’intérêts, 25 ans après cette publication qui a entre-temps guidé nombre de décisions politiques malgré des alertes quant à la probité de ses auteurs. Si des chercheurs ont salué cette rétractation, sa lenteur interroge quant à l’intégrité de la recherche menée autour de l’ingrédient clé du Roundup, herbicide le plus vendu dans le monde. Publié en 2000 dans le journal Regulatory Toxicology and Pharmacology, l’article désormais retiré figure parmi les plus cités sur le glyphosate, notamment par de nombreuses autorités gouvernementales qui en réglementent l’usage. Dans sa note de rétractation publiée la semaine dernière, le journal cite toute une série de lacunes « critiques » : omission d’inclure certaines études sur les dangers liés au cancer, non-divulgation de la participation de salariés de Monsanto à son écriture et non-divulgation d’avantages financiers perçus par les auteurs de la part de Monsanto. Elsevier, l’éditeur du journal, a assuré à l’AFP que la procédure de réexamen de l’étude a été entamée « dès que le rédacteur en chef actuel a pris connaissance des préoccupations concernant cet article, il y a quelques mois ». Dès 2002, une lettre signée par une vingtaine de chercheurs dénonçait déjà « des conflits d’intérêts, un manque de transparence et l’absence d’indépendance éditorial » au sein de la revue scientifique, en mentionnant Monsanto.