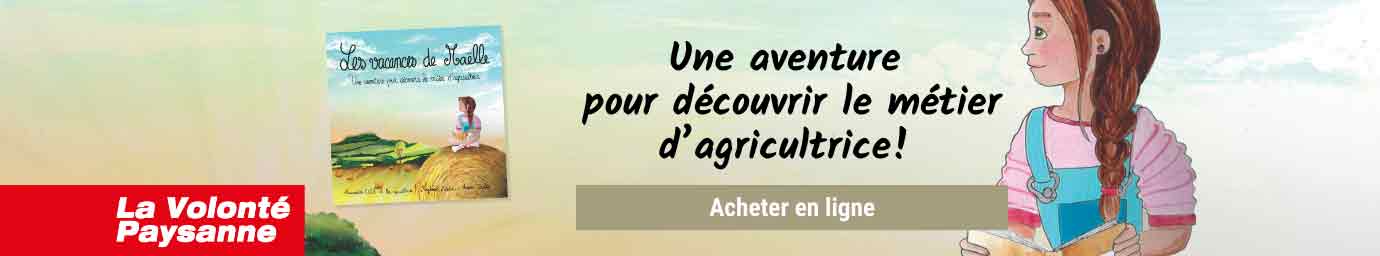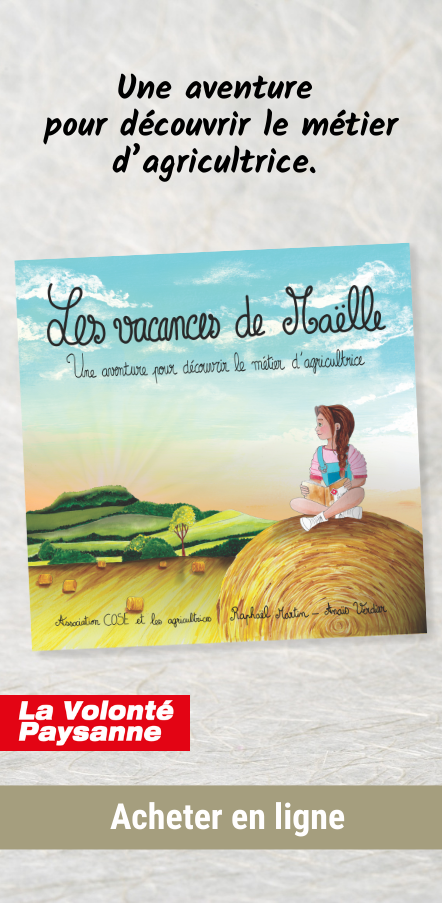National | Par Actuagri
Combinaison de ressentiments politiques, économiques, sociaux et religieux, la révolte des Paysans du Saint-Empire romain germanique a vu s’opposer il y a un demi-millénaire des bandes armées de pays et de ruraux (artisans) au pouvoir seigneurial et religieux.

Illustration Guerre des Rustauds © DR
Tout a commencé à l’été 1524 quand la comtesse de Lupfen, la maîtresse les lieux a imposé à ses serfs et paysans de ramasser pour son bon plaisir et sa cuisine, des escargots et des fraises des bois. C’était la corvée de trop pour des paysans déjà excédés par la hausse des redevances et les caprices de leur comtesse, qui devaient, en plus assurer les moissons de l’immense domaine, situé dans la région de Stühlingen à proximité de la Forêt-Noire. Les paysans prennent les armes, se révoltent et se font quelque peu rosser. Cependant, la contestation qui réclame l’abolition de l’esclavage et sur servage ne faiblit pas. Il prend même de l’ampleur à la faveur de la Réforme protestante qui «est involontairement compris dans la paysannerie comme le signal d’une rébellion contre l’ordre social d’alors», explique l’historien Adrian Thomas, spécialiste de l’histoire ouvrière et du communisme.
Fin 1524, des armées improvisées arpentent l’Alsace, le sud et centre de l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse, écrivant des listes de doléances. Les revendications sont locales, religieuses et sociales. Leur programme, décliné en XII articles, dénonce l’exploitation des serfs, le droit féodal et les taxes du seigneur et de l’Église mais aussi les premières enclosures qui dépossèdent les paysans des communs (pâturages, forêts). Bien avant Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), c’est aussi le droit à une propriété privée que ces populations réclament car c’est cette propriété qui est source d’inégalités… Les paysans pensent que les nobles pourraient accepter ce nouvel ordre social, car certains d’entre eux, à l’esprit plus large et plus éclairé rejoignent leur combat, à l’image du chevalier Florian Geyer von Giebelstadt. Il utilise d’ailleurs sa fortune personnelle pour appuyer militairement les paysans vite appelés Die Schwarze Haufen («La Bande Noire») en raison des uniformes noirs qu’il leur a fournis. Cette nombreuse troupe occupe plusieurs petite villes jusqu’en juin 1525 quand Florian Geyer von Giebelstadt est assassiné par des envoyés de son beau-frère Wilhem von Brumbach qui rusèrent en prétendant vouloir l’aider.
Taillés en pièces
La révolte atteint alors son paroxysme car depuis l’assassinat de hauts dignitaires à Weinsberg le 16 avril 1525, les armées princières ont commencé à réprimer et décimer par milliers les paysans région par région. La France actuelle n’est pas épargnée : Alsace, Lorraine, Franche-Comté sont touchés. Les positions se radicalisent sous l’effet d’un certain Thomas Müntzer (1489 ou 1490-1525) qui entend aller encore plus loin que Martin Luther et justifie «le rétablissement de l’Église apostolique par la violence s’il le faut» . Lui-même essaie de mettre ses paroles en action en imposant dans la ville de Mülhausen (Thuringe) une sorte de théocratie «radicale et égalitaire». Thomas Müntzer se retrouve avec son armée face à une coalition de nobles catholiques et protestants notamment conduits par le landgrave Philippe 1er de Hesse (1504-1567 – protestant) et son beau-père (catholique) le duc Georges de Saxe (1471-1539). L’armée des paysans insurgés compte environ 7000 à 8000 individus faiblement armés de fléaux, fourches, faux et massues, avec quelques cavaliers mais par d’artillerie. Les troupes des princes, plus aguerries, sont fortes de 6000 soldats composées de trois armes : l’infanterie équipée de piques, d’hallebardes et d’arquebuses ; l’artillerie de campagne composée de pièces «légères» (serpentines, coulevrines…) et une cavalerie cuirassée. La bataille de Frankenhausen s’engage de 15 mai 1525. Les paysans sont littéralement taillés en pièces. Les 6000 morts sont atteints côté insurgés. Les autres sont faits prisonniers et la moitié sont passés par les armes le lendemain matin. Quant à Thomas Müntzer, il est arrêté, jugé et exécuté par décapitation le 27 mai suivant.
Analyse marxiste
«Pourtant courantes au XVe siècle, les jacqueries disparaissent durant trois siècles en Allemagne», constate Adrian Thomas pour qui le «ralliement attentiste de la bourgeoisie à la structure féodale impériale va ralentir l’essor du capitalisme en Allemagne». Mais c’est bien sur les fondations du luthérianisme et du calvinisme que l’économie allemande prendra plus tard son essor. Surtout, la révolte des Rustauds va être «ressuscitée» au XIXe siècle par les marxistes allemandes, notamment par le philosophe Friedrich Engels (1820-1895) qui y voit la première lutte de la bourgeoisie contre le féodalisme. «1525 devient pour lui un exemple vibrant de l’analyse marxiste de l’Histoire (matérialisme historique)», souligne l’historien. Au point qu’Engels publie en 1850 un ouvrage sur cette révolte intitulé : «La Guerre des paysans en Allemagne». Il faut par ailleurs souligner que la République démocratique d’Allemagne (RDA) a politiquement et culturellement exalté cette révolte à travers de nombreuses œuvres (tableaux, gravures, statues, médailles, plaques, billets, timbres, chansons) et des films, avec, en particulier une super-production « Thomas Müntzer » (1956).
Actuagri