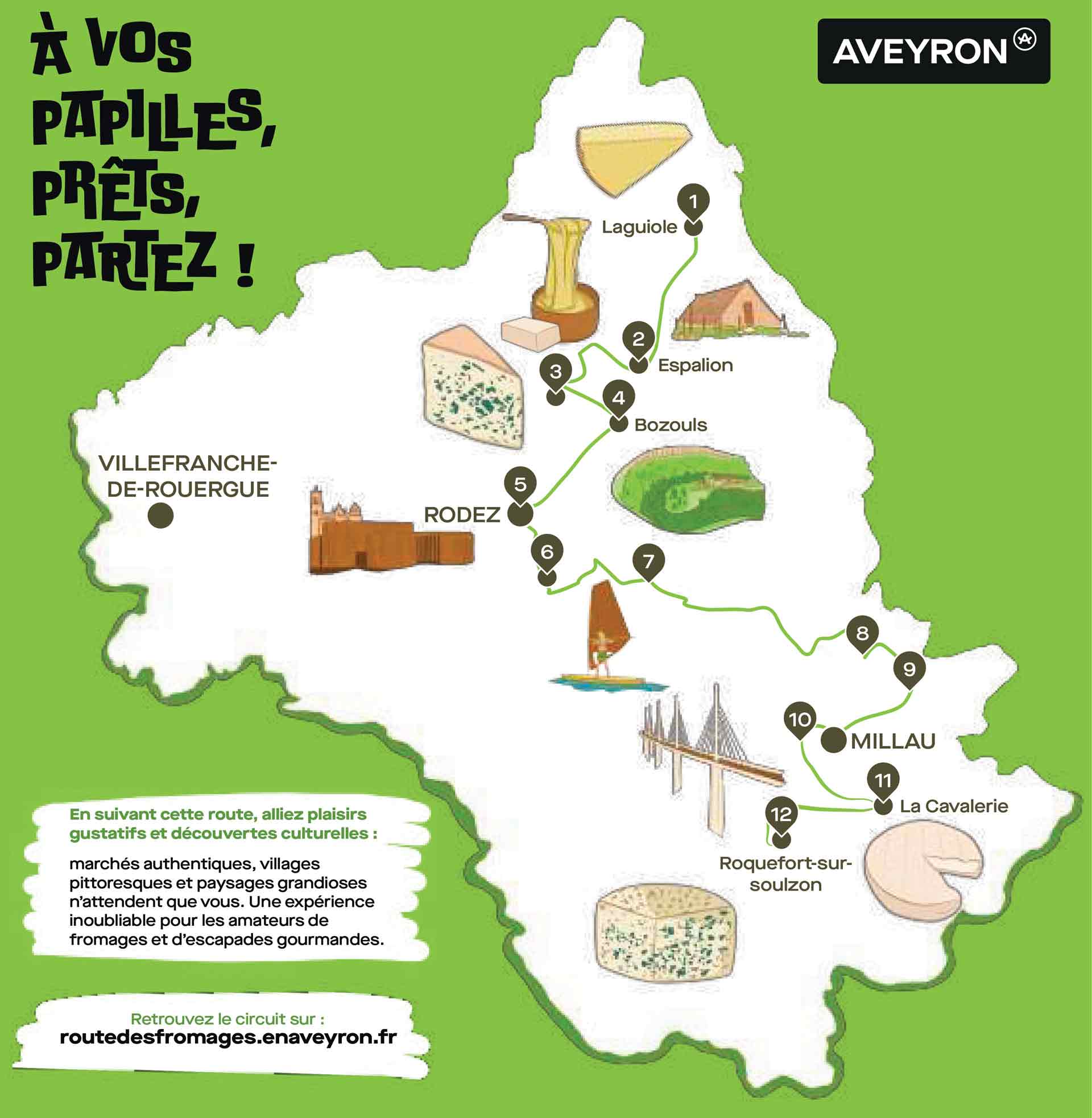«On compte sur vous pour la campagne de lait 2020: vous avez jusqu’au 15 février pour déclarer votre don de lait à votre laiterie», lancent les Restos du cœur en direction des producteurs laitiers dans un communiqué du 23 janvier. L’année dernière, près de 2,7 millions de litres de lait ont été collectés par l’association «grâce à la générosité de plusieurs centaines d’agriculteurs et à l’appui de la filière laitière», se félicite l’association. Chaque année, les Restos du cœur en distribuent plus de 20 millions de litres. En pratique, le producteur doit se rapprocher de sa laiterie pour savoir si elle est partenaire des Restos du cœur (ou d’une autre association habilitée à recevoir les dons). La laiterie collecte et transforme le lait donné en produits finis avant de le reverser à l’association. Les producteurs de lait qui feront un don pourront bénéficier d’une déduction fiscale de 60% de la valeur de leur don, dans la limite de 5 pour 1000 du chiffre d’affaires hors taxes de l’exploitation.
Didier Bouville