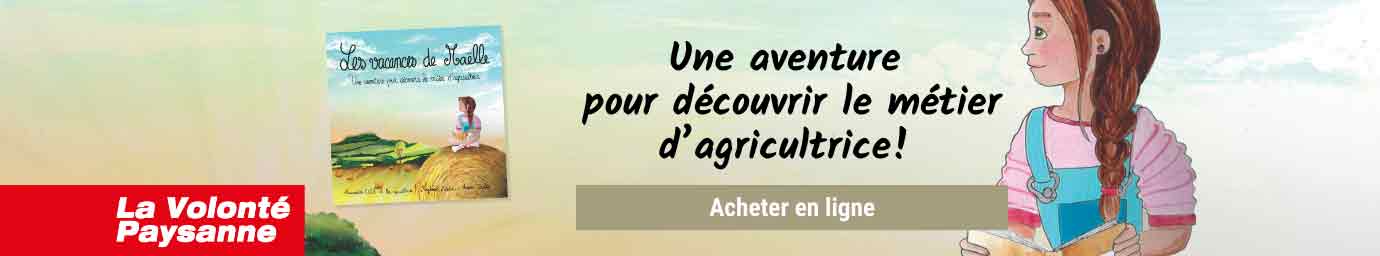La première édition d’un observatoire économique et financier de la filière vinicole a été publiée le 16 octobre par les Vignerons coopérateurs et le HCCA (Haut conseil de la coopération agricole). Etabli sur la période 2017-2022, il montre un «retour à la profitabilité» des caves coops, après une série de crises liées à la météo, l’économie, la géopolitique. Les coopératives viticoles sont «en phase de convalescence», a souligné le président de la commission économique et financière du HCCA François Macé, lors d’un conseil de section à la Coopération agricole. Leur rentabilité opérationnelle, mesurée par le ratio entre Ebitda et chiffre d’affaires, atteint 5,68 % en 2021, un niveau plus élevé qu’en 2018. Mais les caves coops sortent d’un passage difficile en 2019 et 2020, y compris financièrement. Ces deux années d’investissement et d’endettement ont affaibli leur levier financier, qui a grimpé entre 11 et 12 (nombres d’années pour rembourser la dette) pour les structures de plus de 10 M€ de chiffre d’affaires, avant de descendre à 6,83 en 2021, soit un chiffre encore «trop important». «La situation pourrait se dégrader à nouveau en 2022, avec la forte augmentation du besoin en fonds de roulement», selon le rapport, en référence notamment à l’explosion des taux d’intérêt.
Didier Bouville