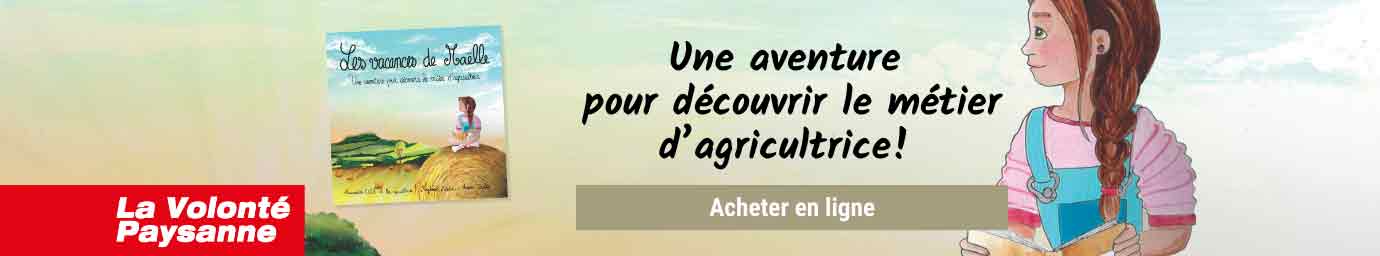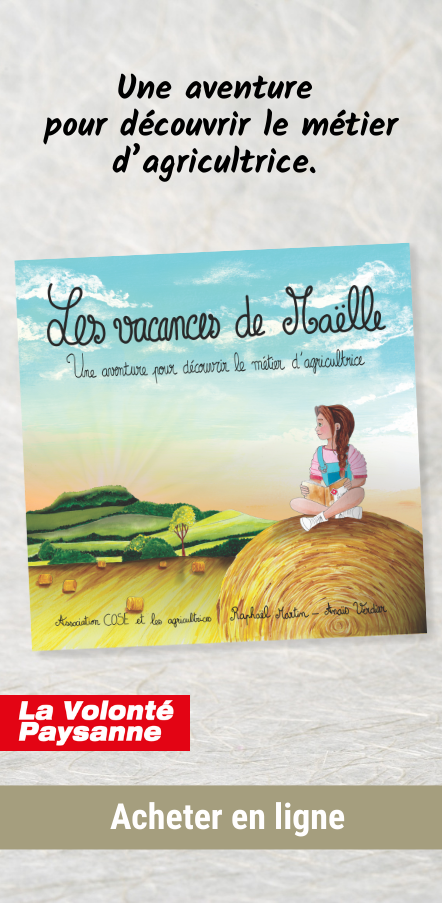Des fabricants français d’alternatives végétales à la viande vont attaquer, devant le Conseil d’État, le décret du 26 février qui leur interdit d’utiliser des dénominations animales pour leurs produits, ont-ils récemment annoncé sur les réseaux sociaux. Dans un message diffusé sur sa
page LinkedIn le 11 mars, le cofondateur de HappyVore Cédric Meston, indique vouloir «déposer un référé» pour faire annuler un texte «injuste» et «pervers»: l’interdiction ne s’appliquant qu’aux entreprises françaises, «un steak végétal produit en Serbie pourra toujours s’appeler « steak » sur vos étalages». Une procédure qu’il dit mener avec «l’ensemble de la filière végétale française», dans un précédent message. La démarche associe la marque La Vie, selon son Pdg
Nicolas Schweitzer. Le
texte attaqué comprend une liste de 21 dénominations animales interdites aux protéines végétales (steak, filet, jambon, etc.), ainsi qu’un taux maximal de protéines végétales pour pouvoir utiliser une centaine d’autres termes (saucisse, rôti, pâté, etc.). Le décret prévoit «un délai d’entrée en vigueur de trois mois après sa publication pour laisser aux opérateurs le temps d’adapter leur étiquetage». Ces dispositions répondent à la demande du Conseil d’État, qui avait
annulé le précédent décret en référé en juillet 2022, pour imprécision et insécurité juridique.
Mallory Bouron