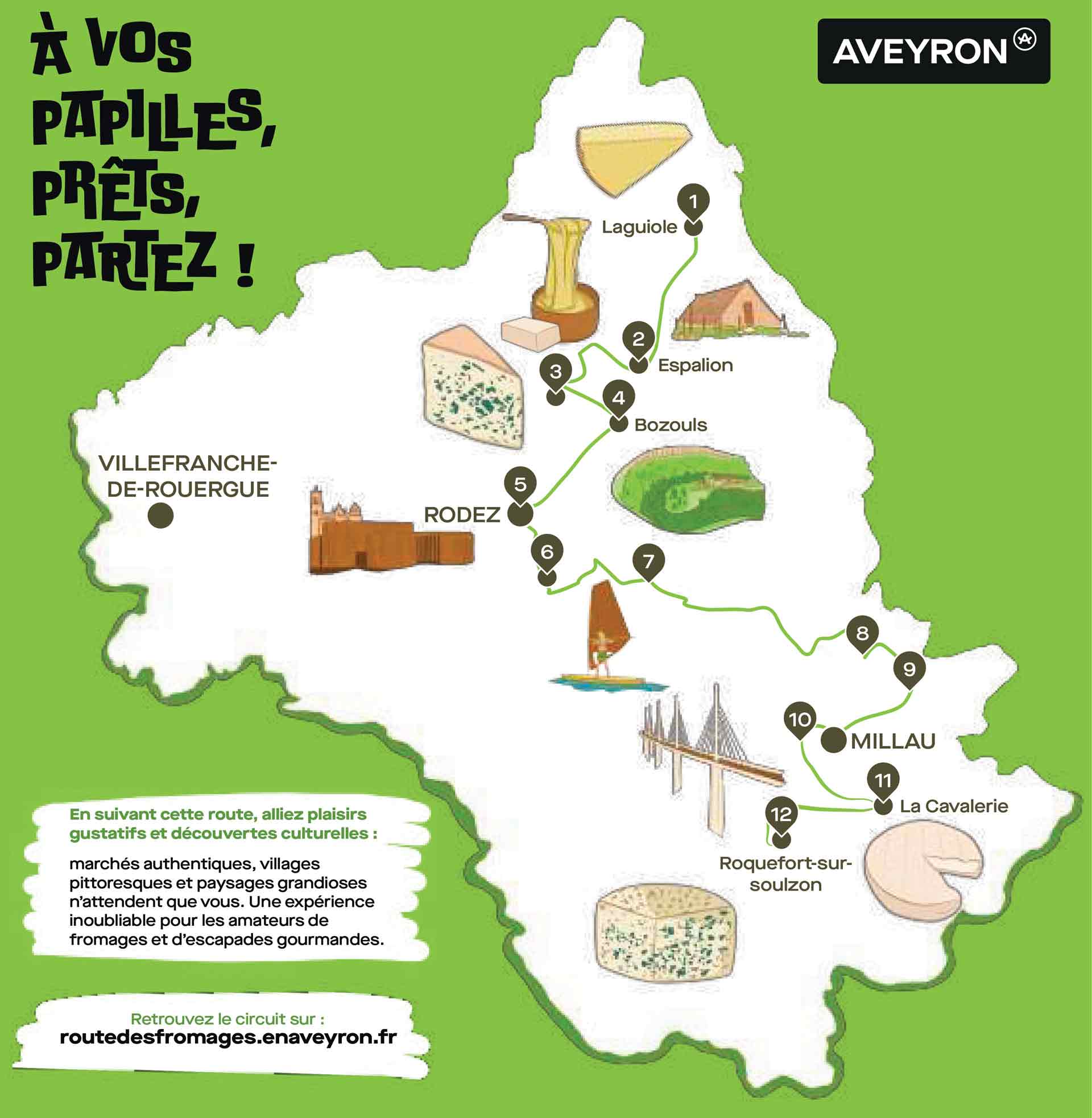Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances (PLF) pour 2022, qui a débuté le 5 octobre en commission des finances à l’Assemblée nationale, les députés ont adopté un amendement pour soutenir l’achat de matériel agricole électrique non polluant. Porté par Eric Girardin (LREM, Marne) et plusieurs pairs du groupe majoritaire, l’amendement vise à permettre «aux professionnels de l’agriculture, tels que les viticulteurs manipulateurs» de bénéficier d’un «suramortissement à hauteur de 20%» pour acquérir du matériel agricole à propulsion électrique. L’idée est d’accompagner davantage les agriculteurs dans la «transition énergétique» en les incitant à investir dans ces équipements électriques qui existent mais demeurent plus coûteux que les matériels fonctionnant au pétrole, explique le député marnais dans l’exposé des motifs.
Eva DZ