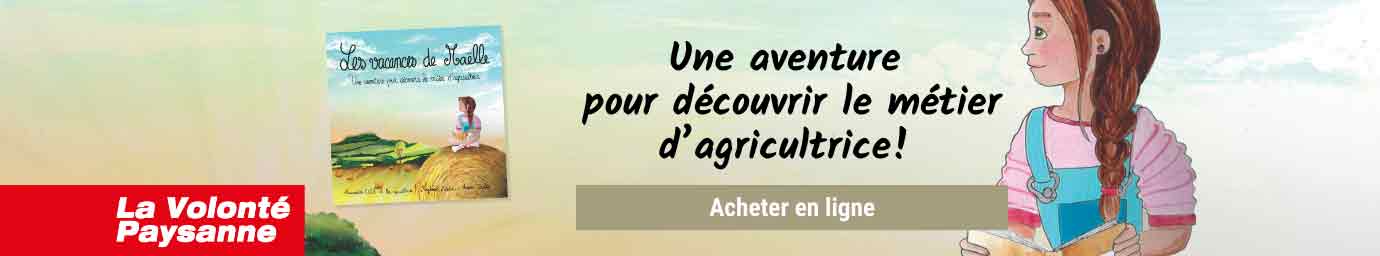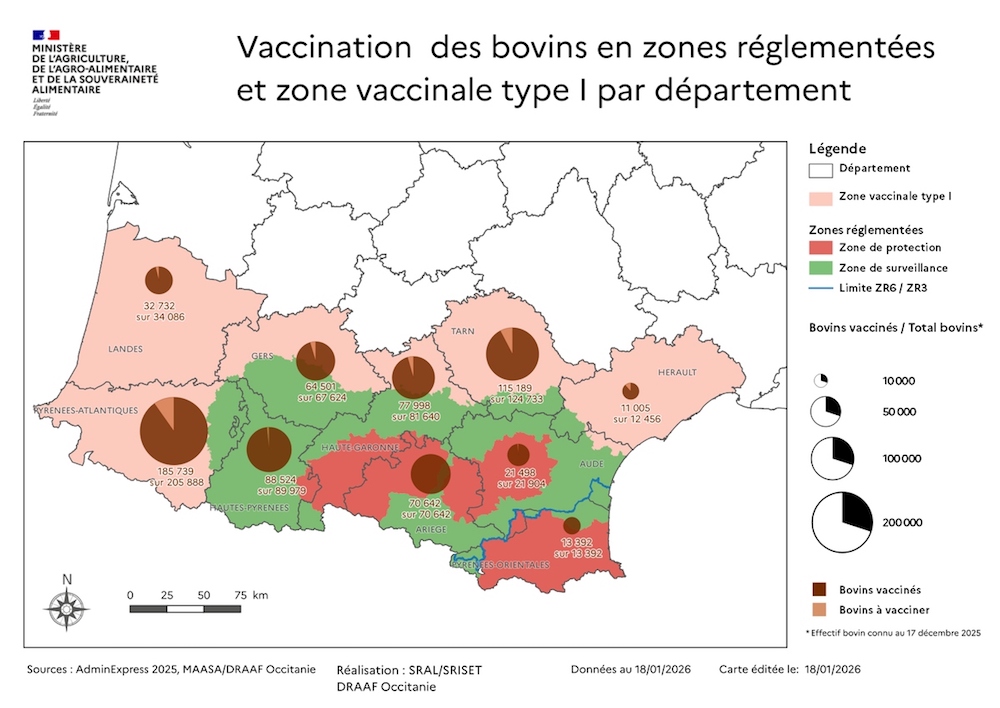À quelques jours de la semaine du foncier qu’organisent chaque année les JA, le syndicat a accordé une place importante à la thématique foncière, lors de sa conférence de presse de rentrée, le 15 septembre, réaffirmant «la nécessité d’une loi foncière». «La France se doit d’élaborer une loi foncière si elle veut rester sur le podium de l’agriculture et de l’alimentation», a souligné Sébastien Richard, vice-président des JA, chargé du foncier. Il a insisté sur les enjeux auxquels devra s’emparer cette loi : la protection des terres face à l’urbanisation, le recensement des friches pour en remettre une partie en culture ou en pâture, le contrôle des achats de foncier agricole par des opérations sociétaires, la définition de l’actif agricole, au moment où un nombre croissant d’agriculteurs ne font plus les travaux des champs mais les délèguent à des prestataires. Sébastien Richard a par ailleurs affirmé la position des JA contre le solaire photovoltaïque au sol. Ces préoccupations seront développées à la semaine du foncier, qui se tiendra du 21 au 25 septembre dans tous les départements, où se tiendront des rencontres avec des élus.
Didier Bouville