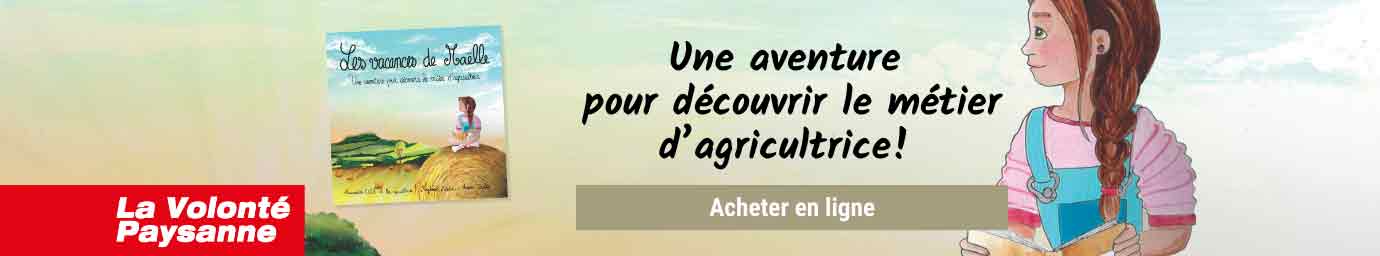«Il ne faut pas remettre en cause la stratégie de développement de l’agriculture biologique», a défendu Marc Fesneau en ouverture des Assises de la bio organisées le 6 décembre par l’Agence bio. Dans un contexte «de rupture», le ministre a annoncé le prolongement d’un an du plan Avenir bio actuel, qui devait se terminer fin 2022, pour «se donner le temps de la réflexion». Des moyens supplémentaires seront notamment accordés à l’Agence bio «pour engager d’ici la fin de l’année des études préparatoires visant à avoir une compréhension plus fine de la crise». Ces premiers résultats alimenteront une étude prospective plus large courant 2023 «qui aboutira à des scénarios de développement de l’agriculture biologique en 2040». L’Agence bio bénéficiera également de 750 000 € de l’État pour lancer une campagne de communication «complémentaire» à celle de «Bioréflexe», avec «une demande à l’ensemble des interprofessions d’apporter leur contribution pour compléter cet apport financier». Côté filière, si le ministre a fermé la porte à des aides conjoncturelles dédiées pour la bio, 2 M€ de reliquat du fonds Avenir bio seront «dédiés à la structuration des filières trop peu développées», notamment le porc. Dans le cadre du PLF 2023, ce fonds bénéficiera de 13 M€ au total, avec une évolution des critères visant à «financer davantage de projets visant à structurer et développer des débouchés». Le ministre a par ailleurs indiqué «essayer de travailler avec la grande distribution, qui a sa responsabilité dans l’organisation des filières».
Didier Bouville