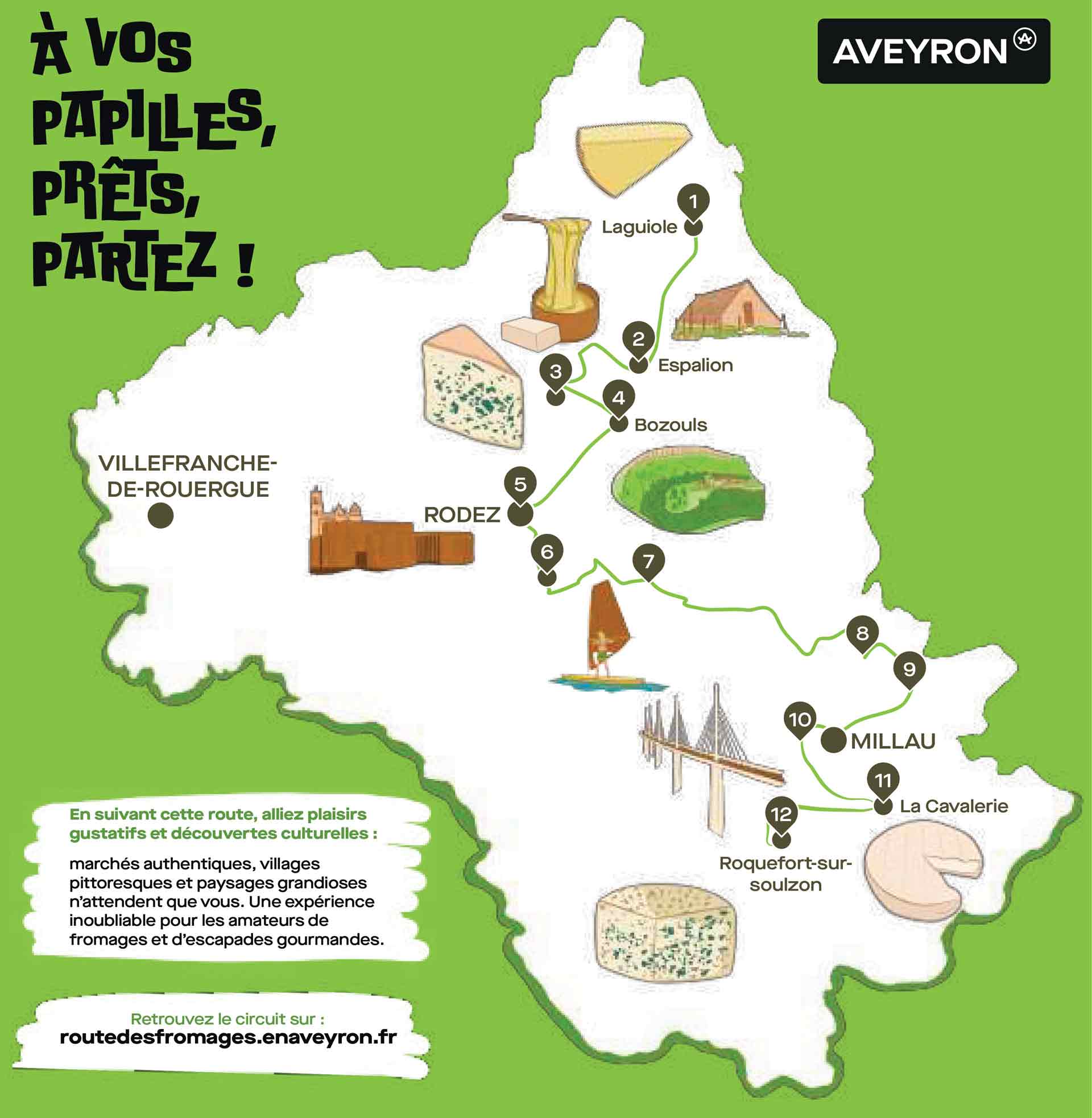Selon les prévisions de Météo France, l’Aveyron est placé en vigilance canicule vendredi 7 août.
L’arrêté du 22 juillet 2019 s’applique : il est interdit de transporter des animaux vivants de 13h à 18h sauf dérogation (véhicules équipés de systèmes de ventilation et brumisation permettant de réguler la température des animaux ou lorsque les transports sont rendus nécessaires pour des raisons vétérinaires ou de protection animale).
L’interprofession préconise l’adaptation des horaires par tous les opérateurs de la filière ainsi que des transporteurs, afin de gérer au mieux cette période entre les différents maillons de la filière :
- Les abattoirs adaptent la présence du personnel en fonction des besoins des apporteurs,
- Les éleveurs, les centres de rassemblement et les marchés aux bestiaux s’organisent pour que les animaux soient mis à disposition avec leur passeport au moment opportun.
Infos : www.interbev.fr/canicule.
Eva DZ