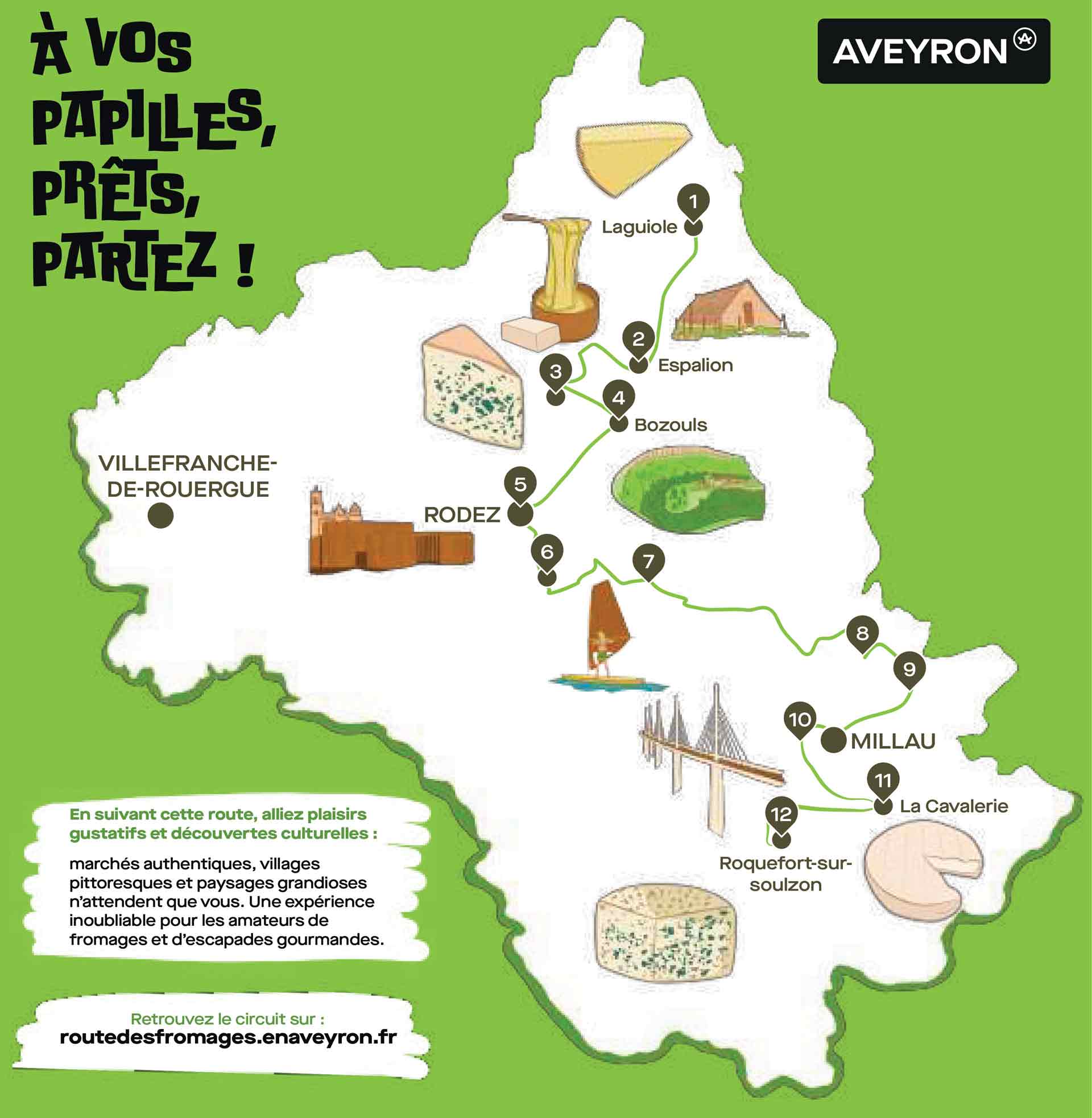Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a indiqué le 11 juin, dans son bulletin mensuel, que « la recharge des nappes phréatiques a été satisfaisante en mai ». Bien que le printemps 2020 qui s’achève se classe au 2e rang des plus chauds en France (source MétéoFrance), avec un mois de mai à plus de 16,5°C, « la situation est satisfaisante, avec des niveaux supérieurs à la moyenne sur une grande partie du territoire », à l’exception toutefois de l’Alsace et du canal rhodanien qui « affichent toujours des niveaux modérément bas à bas, conséquences de déficits pluviométriques successifs ». Reste que les pluies de juin pourraient « avoir un effet bénéfique sur les nappes les plus réactives », estime le BRGM.
Didier Bouville